
Travail. Les jeunes changent changent de curseurs
La Revue Projet, c'est...
Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.

Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.
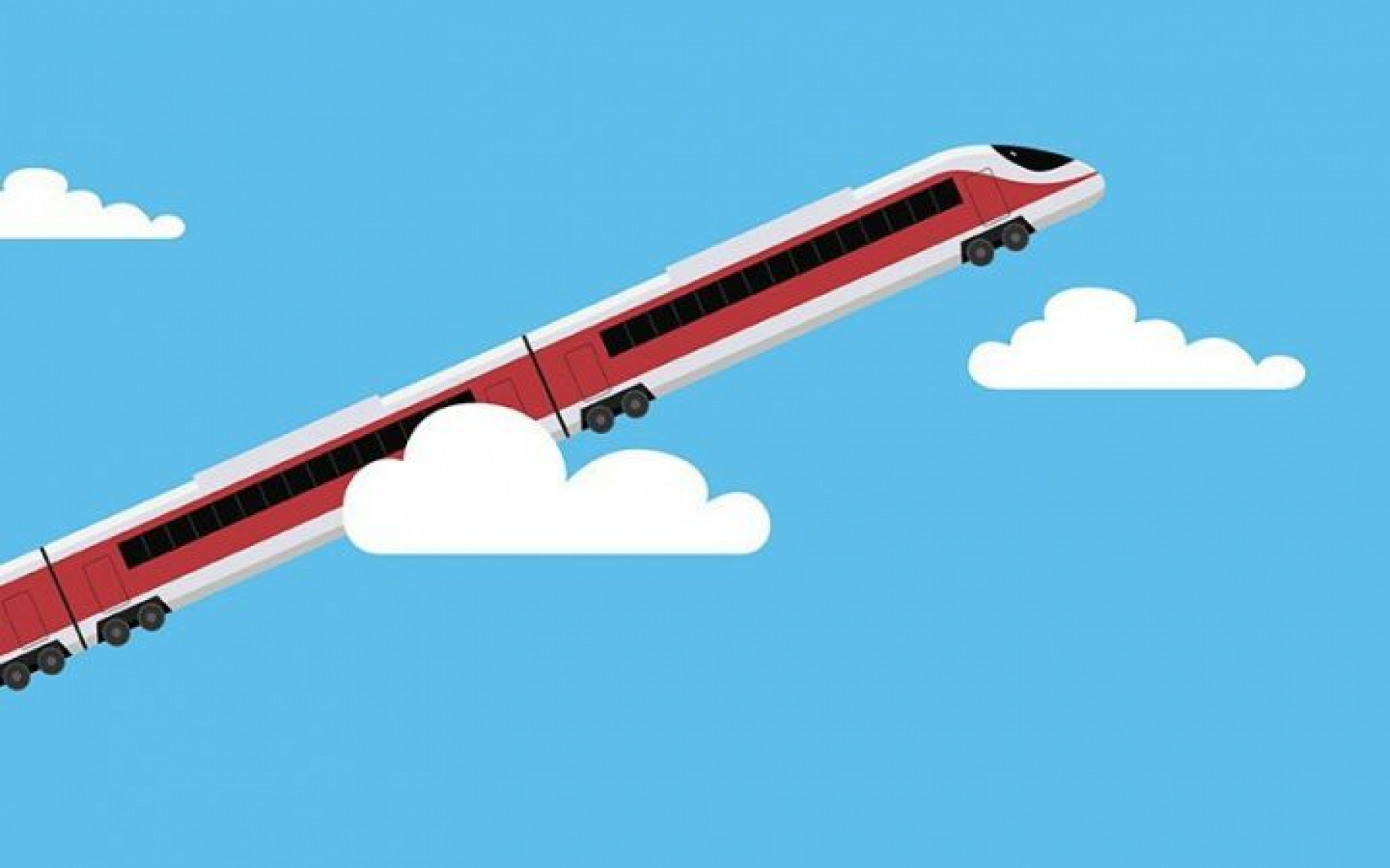
Pour défendre des propositions innovantes en cette année électorale, le Pacte du pouvoir de vivre mise sur le dialogue inter-structures, le temps long et une écoute fine du terrain.
Dans un contexte sanitaire, social et écologique plutôt angoissant, le Pacte du pouvoir de vivre ne veut plus d’un système qui écrase les plus faibles et détruit l’écosystème. Alors que les alarmes retentissent, cette coalition de soixante-cinq organisations de la société civile cherche à construire une nouvelle donne politique. Un pacte du pouvoir de vivre, aujourd’hui et demain, dans la dignité et le respect, un pacte qui nous engage tous.
Mais comment le décliner en propositions concrètes et motivantes, qui puissent parler aux citoyennes et citoyens ? En octobre 2020, les organisations du Pacte du pouvoir de vivre décident de s’engager dans un grand chantier pour mettre à jour le projet social, écologique et démocratique qu’elles souhaitent présenter aux décideurs publics et à l’ensemble de la société en vue des prochaines élections nationales.
Structurés par thématique, les groupes de travail se lancent en janvier 2021. Aux représentants d’organisations du Pacte qui y prennent part sur la base du volontariat s’ajoutent des experts se reconnaissant dans les valeurs du projet. La fabrique des propositions peut commencer. D’abord, par une émulation entre les idées, les projets et les défis propres à chacun. Ces défis sont ancrés dans les réalités et le compagnonnage que nos organisations vivent, dans leur territoire, avec les personnes, les structures ou la nature en difficulté.
Au sein du Pacte, la conviction se renforce qu’on n’a pas tout essayé contre le chômage.
« Un emploi, un revenu juste, un logement digne pour tous, c’est possible. » L’intitulé de ce groupe en traduit l’ambition. Afin d’identifier les orientations d’une politique de l’emploi solide, susceptibles d’être portées par le Pacte, un sous-groupe se focalise sur la question de l’emploi. Les discussions sont vives autour de la notion de « garantie d’emploi », profondément novatrice, et les transformations du marché du travail sont au cœur des débats.
Il s’agit également de préciser le chemin vers une lutte plus efficace contre le chômage de longue durée. La conviction se renforce qu’on n’a pas tout essayé contre le chômage et qu’il faut stimuler notre capacité d’imagination créative dans ce domaine. In fine, le groupe se met d’accord sur une proposition visant à assurer une garantie d’emploi contre le chômage de longue durée, à mettre en œuvre sur les territoires.
Cette proposition émerge d’un contexte porteur. En 2018, l’économiste américaine Pavlina Tcherneva démontrait1 qu’il est possible de fournir à tous les citoyens qui le désirent un travail rémunéré, dans la tradition keynésienne de l’État employeur en dernier ressort. Pour écarter l’objection de ceux qui voient là une étatisation de l’économie, Tcherneva propose que la garantie d’emploi permette de créer des emplois utiles pour la société et répondant à des besoins identifiés démocratiquement.
La campagne « Un emploi vert pour tous » s’inspire de l’expérience positive de l’association Territoires zéro chômeur.
En France, le sujet est repris dans une tribune portée par les chercheuses en sciences sociales Julie Battilana, Isabelle Ferreras et Dominique Méda, en quête d’un progrès social et écologique autour du renouvellement du travail dans nos sociétés. Signée par plus de 6 000 chercheurs du monde entier, elle se déclinera en 2020 en un livre2 recueillant des articles de femmes engagées dans la transition sociale et écologique (on y retrouve notamment une contribution de Pavlina Tcherneva).
La campagne « Un emploi vert pour tous », portée par les laboratoires Hémisphère gauche et l’institut Rousseau, introduit l’idée d’une « garantie à l’emploi vert » dans le débat public. La campagne s’inspire de l’expérience positive de l’association Territoires zéro chômeur de longue durée (membre du Pacte du pouvoir de vivre), qui propose des emplois à durée indéterminée à des chômeurs de longue durée, dans le cadre d’entreprises à but d’emploi.
Les membres du groupe « Emploi » élaborent dans ce contexte un ensemble de propositions en insistant – et c’est là une des lignes de force – sur la nécessaire dynamique territoriale pour mettre en œuvre une telle garantie. Il ne s’agit pas d’une démarche venant d’en haut et s’imposant aux acteurs. L’enjeu est de soutenir et renforcer les dynamiques locales permettant de garantir une embauche à tous les chômeurs de longue durée en recherche. En partant de leurs talents et désirs et des besoins (repérés démocratiquement) non satisfaits dans les territoires, sont créés des emplois utiles tant à la transition écologique qu’aux habitants.
Une idée forte et innovante prend ainsi corps dans les propositions du Pacte du pouvoir de vivre, enracinée dans les longues maturations de l’histoire des idées plutôt que dans un éphémère « eurêka ». Alliant audace et réalisme, elle fait confiance à la capacité d’innovation et de mobilisation des acteurs sur le terrain, dans les bassins de vie et territoires, tout en proposant les mécanismes et financements (emplois aidés, soutien à l’insertion par l’activité économique, etc.) permettant de changer d’échelle.
Le Pacte montre qu’il est possible de sortir de la crise actuelle en reconstruisant autrement notre société .
Le temps long de l’échange a permis au Pacte du pouvoir de vivre de disposer aujourd’hui d’un solide socle de propositions. S’il montre le sérieux des organisations membres, ce socle peut souffrir de formulations parfois trop technocratiques. Le Pacte a besoin d’être incarné et de permettre à chacun de se projeter vers la société que nous voulons dans les cinq ans à venir. C’est le rôle de la narration, qui met en « récit » cet ensemble de propositions.
Le Pacte montre qu’il est possible de sortir de la crise actuelle en reconstruisant autrement notre société : en développant le pouvoir de vivre de chacun, en prenant soin de ce qui nous relie à nous-même, aux autres et à la nature, en contribuant à une société plus fraternelle et solidaire, en combattant les inégalités et les injustices, en accélérant la transition écologique, en participant enfin à une démocratie renouvelée et au partage du pouvoir.
Ce processus de construction commune nous convainc qu’il est possible et nécessaire d’allier écologie, justice sociale et démocratie. Nous pouvons développer notre pouvoir de vivre, dans la dignité, en ne laissant personne sur le bord du chemin, et dans les limites d’une seule planète. Imagine !