
Travail. Les jeunes changent changent de curseurs
La Revue Projet, c'est...
Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.

Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.
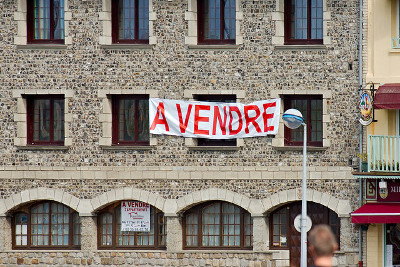
Pour appréhender la géographie du mal-logement, les statistiques aident peu, car la précarité de l’habitat émerge dans un espace discontinu, en archipel ou en îlots. En 2013, le gouvernement repérait 28 agglomérations de plus de 50 000 habitants caractérisées par de fortes tensions entre offre et demande de logements : les « zones tendues ». Des zones à privilégier pour accélérer les projets de construction1. Une taxe sur les logements vacants et un encadrement de l’évolution des loyers (hors Paris) y sont aussi appliqués.
Parmi ces « zones tendues », il faut mettre à part la côte touristique méditerranéenne et les zones frontalières avec la Suisse et l’Italie, qui comptent une population riche, vieillissante et propriétaire. L’accès au logement pour les plus démunis y est très difficile, même si le taux de pauvreté y est plus faible que la moyenne nationale. Les littoraux atlantique et méditerranéen (hors Côte d’Azur), eux, même s’ils manquent de logements, ne figurent pas parmi les zones tendues. Ces régions côtières, dynamiques en termes d’emploi (+ 2 % par an depuis dix ans2), attirent ainsi les jeunes et les travailleurs. Sans surprise, ce sont la région parisienne et les agglomérations de Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lille et Nantes qui constituent les principales « zones tendues » de la loi Alur. Elles concentrent une large part de la population et de l’emploi3, avec une « croissance démographique plus forte des couronnes d’aires urbaines relativement à leur ville-centre4 ».
Par contraste, une diagonale des régions centrales allant du Nord-Est au Sud-Ouest de la France est en paupérisation flagrante : taux de pauvreté dépassant les 13 %, peu de jeunesse, démographie en berne, dynamique économique faible, taux de logements vacants très élevé (plus de 13 %). Ce sont les zones « désertées ».
En bref, le concept de « zones tendues » n’est pas un indicateur suffisant pour décrire l’accessibilité du logement pour les plus démunis. Le taux de logements vacants est peut-être plus adapté, assorti d’une vision dynamique de la démographie et de la précarité. Une précarité qui se concentre et s’accroît dans le Nord de la France (Lille et Ardennes), la Creuse, la couronne méditerranéenne (jusqu’à Marseille) et la Corse, avec des taux avoisinant les 20 %. Les seuils dépassent les 28 % de personnes en situation de pauvreté en Seine-Saint-Denis et dans les départements d’outre-mer5.
1 « Les zonages des politiques du logement », ministère de la Cohésion des territoires, 09/02/2015.
2 Stéphanie Mas (coord.), Atlas des zones d’emploi 2010, Insee/Dares/Datar, 2010, p. 35 et La France et ses territoires 2015, Insee, 15/04/2015, p. 39.
3 10 % des zones d’emploi (31 sur 322) concentrent la moitié des emplois et 18 % de l’emploi est situé à Paris, Roissy-Sud, en Picardie et Saclay. Cf. Atlas des zones d’emploi 2010, op. cit., p. 32.
4 La France et ses territoires 2015, op. cit., p. 33.
5 « Statistiques locales », « Taux de pauvreté (%) 2014 », <https://statistiques-locales.insee.fr>, Insee.