
Les langages de la transition
La Revue Projet, c'est...
Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.

Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.
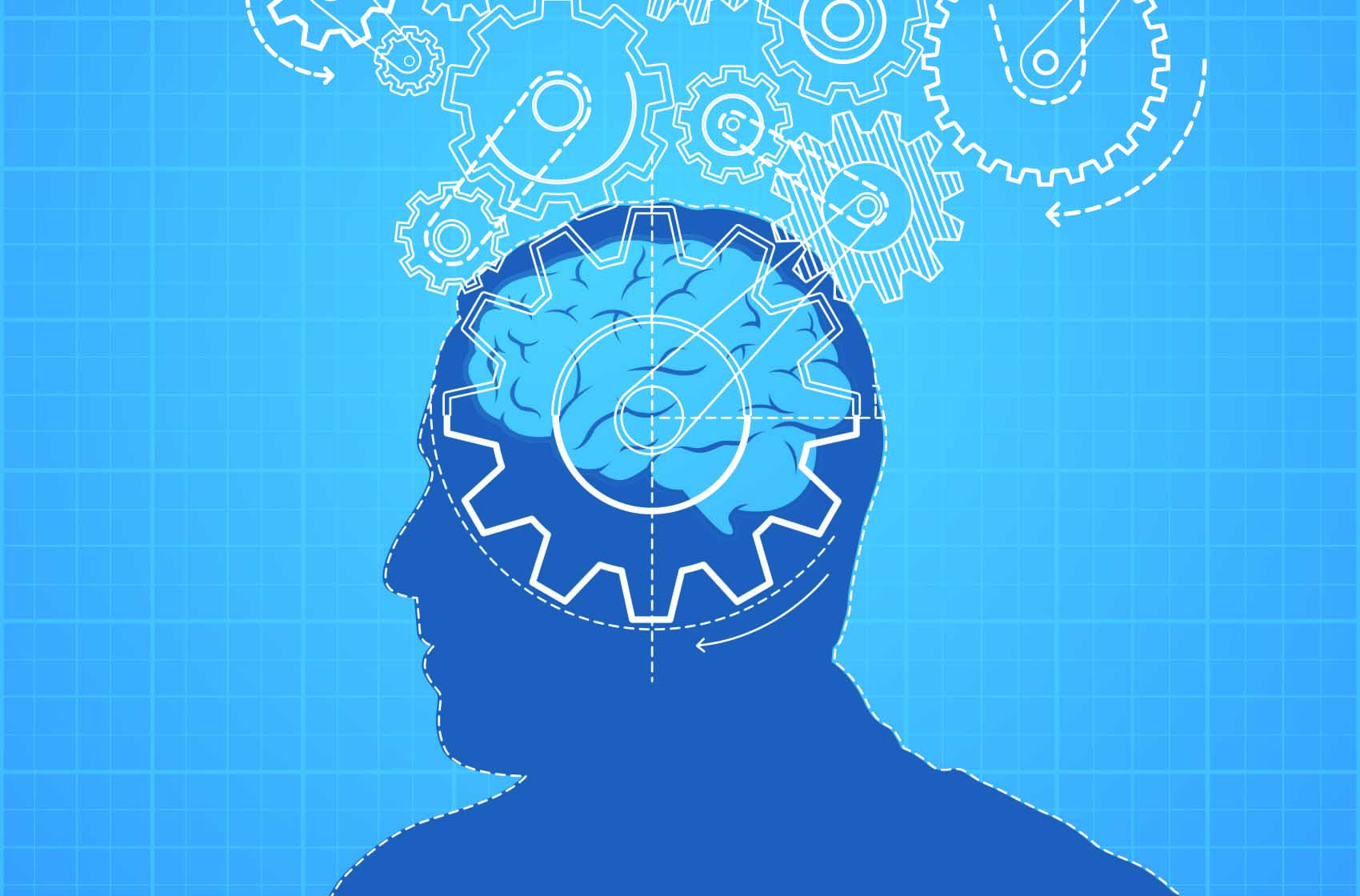
Au cœur de l’activité politique, la décision polarise l’attention et les critiques : trop timorée face à la crise climatique, trop autoritaire face à l’urgence sanitaire… Est-il possible de rendre la décision plus démocratique, plus inclusive ? Cinq points saillants se dégagent à la lecture de ce dossier.
Si, même en démocratie, la décision peut apparaître comme le « fait du Prince », elle est en réalité toujours collective : elle implique au minimum une élaboration au sein d’un cabinet, sa relecture par une instance chargée de vérifier sa compatibilité avec l’État de droit, et elle est souvent soumise à la discussion publique du Parlement. Toutefois, l’exigence croissante d’une démocratie qui ne se limite pas au moment du vote, mais implique de façon beaucoup plus continue l’ensemble des citoyens suppose que cette participation ne s’arrête pas aux portes de la décision.
Héloïse Nez nous montre comment, à la suite du mouvement des Indignés de 2011, certaines villes espagnoles ont su inventer des pratiques dans lesquelles des citoyens ordinaires sont associés aux élus et aux experts pour prendre des décisions concernant leur vie quotidienne. Parmi les leçons de l’expérience espagnole : il ne faut pas hésiter à combiner différentes conceptions de la démocratie (participative, directe, délibérative, numérique), du moment que ces dispositifs prennent un caractère effectivement décisionnel, ce qui n’est pas toujours le cas.
Ne pas répondre à ces aspirations, c’est prendre le risque d’un enfermement dans les pires manières de décider. Celles-ci sont évoquées en creux au fil du numéro : confiscation de la décision par les lobbies, les marchés, les agences de notation, ou encore par des expertises non contradictoires. Anne Marijnen nous alerte sur la place croissante, au niveau des gouvernements, des décisions automatisées, où des algorithmes él
vous pouvez l’acheter à l’unité pour 3€
Pour accéder à cet article :
La Revue Projet donne gratuitement accès aux articles de plus de 3 ans.