
Travail. Les jeunes changent changent de curseurs
La Revue Projet, c'est...
Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.

Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.
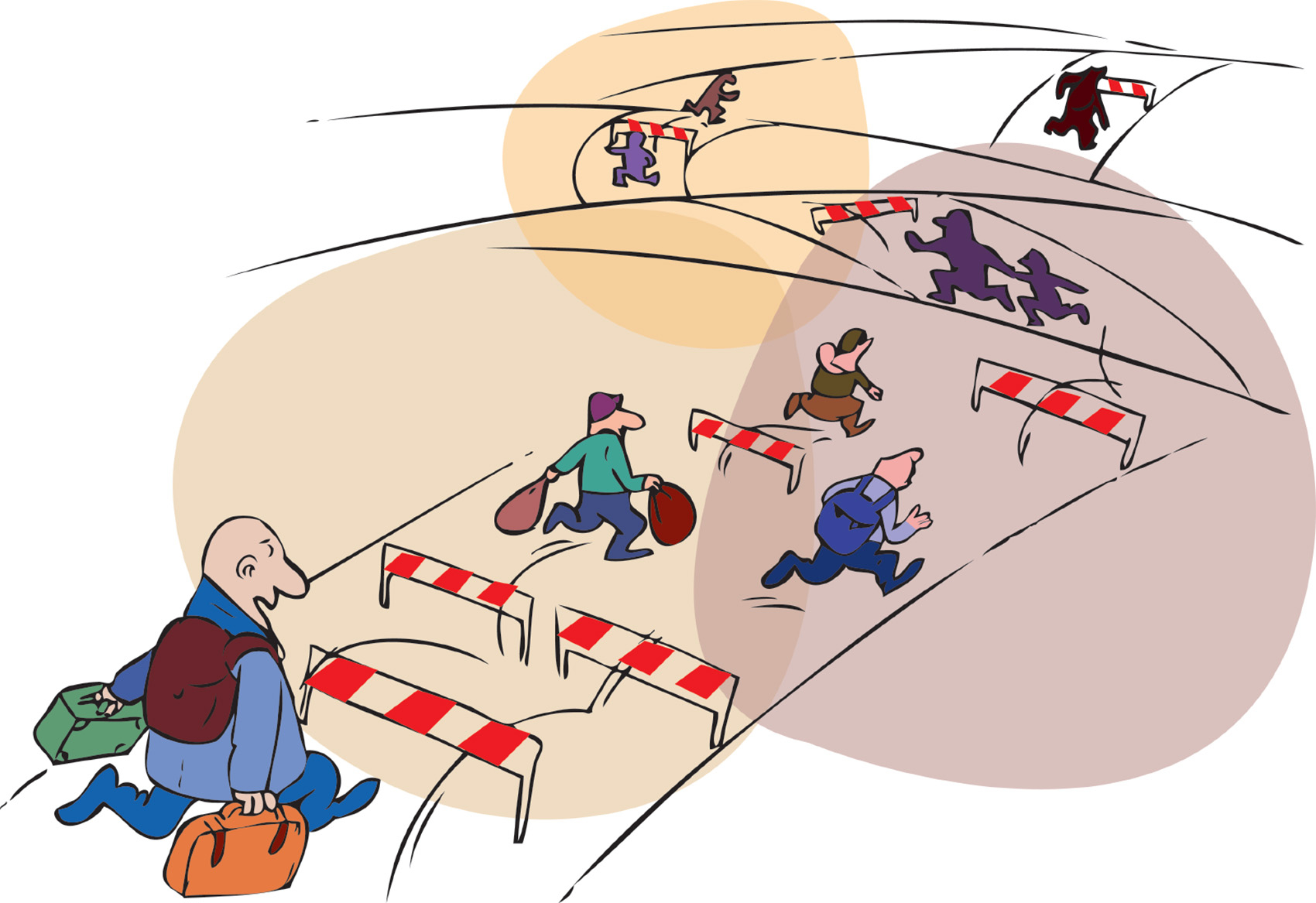
Pour Raoul, Adil et François, travailler permet d’être reconnu comme une personne normale, utile pour la société. Au-delà des cases auxquelles ils sont assignés tout au long de leur parcours migratoire.
J’étais venu en France pour mes études, puis je suis rentré chez moi, et mes déboires ont commencé. J’ai repris la route en 2014 et, à peine arrivé en France, on m’a mis une OQTF, une obligation de quitter le territoire français ! J’étais clandestin. J’ai voulu partir en Espagne, je pensais que la démocratie y était meilleure, mais je me suis fait attraper par la police et j’ai dû demander mon asile en France. J’ai ressenti de l’incompréhension et du dédain envers moi. À cause de l’afflux de migrants, ils avaient une idée en tête et il m’a fallu une bataille juridique pour décoincer la situation, puis un autre combat pour mon logement. Devenu précaire, je suis allé dans un squat.
Dans le système français, on a accès à la santé et au logement, mais ces droits ne sont pas respectés. Au collectif Russeul, nous vivons une grande cohésion sociale. Nous avons trouvé beaucoup de soutien et nous avons pu occuper plusieurs logements libres.
Le nombre de personnes est monté jusqu’à 700 ou 800. Chacun venait d’un horizon différent avec des perspectives différentes. On a créé un système d’organisation et d’autogestion, le Réseau d’entraide populaire international toulousain (Repit). Les habitants ont vu l’efficacité du collectif pour tout ce qui était interne, lié à la distribution de l’alimentaire et à des aides juridiques. On a fait appel aux partenaires extérieurs qui sont venus massivement.
Sur place, on vit la même cause : la régularisation. Au fond, c’est ça qui construit une solidarité forte, une vie entre nous. Ceux de l’extérieur sont étonnés de trouver des gens toujours joyeux, qui ne parlent pas de leur misère.
Il faut peut-être classer les humains, mais les cases, pour nous, ça joue sur les droits primaires, comme le droit au travail.
La préfecture, face à nos demandes, a voulu faire des évaluations administratives et sociales. Un exemple : une personne malade ne pouvait pas rentrer chez elle, or ça fait plus de quinze années qu’elle est sans papiers. C’est une situation humaine qui doit être réglée, et là les militants ont aidé : ça relève des droits de l’homme. Nous ne sommes pas particulièrement en infraction, mais nous nous sentons classés dans des cases ; ce qui est étrange, car nous avons la même demande. Il faut peut-être classer les humains, mais les cases, pour nous, ça joue sur les droits primaires, comme le droit au travail. Nous pouvons avoir une compétence ou une utilité publique, mais notre demande de travailler n’est pas prise en compte, à cause du papier que l’on a obtenu. Avec ça, on passe à côté des capacités des gens.
Dans les moments plus personnels, comme la religion, les « cases » disparaissent ; c’est le cas aussi pour les chrétiens. Lorsque, à l’intérieur, vous avez une croyance, il n’y a pas ce dédain lié aux catégories. C’est autre chose qui parle.
Il faut donner accès au travail. Je pense que ça pourra faire du bien à l’économie et valoriser les talents dans des domaines comme le travail agricole ou la maçonnerie, où il n’y a pas assez de travailleurs. Il y a des boulots où les gens sont capables, et c’est bien dommage qu’on ne les valorise pas.
L’entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) était un peu difficile. Il faut se rappeler beaucoup de choses, et même des choses dures que je veux oublier.
Nous sommes tous des demandeurs d’asile, mais pour différentes raisons. Certains de mes amis ont attendu quelques années pour obtenir un statut. De plus, comme demandeur d’asile, tu ne peux pas travailler, pas faire d’études. Il y a les réfugiés qui ont déjà obtenu les papiers : ils peuvent donc travailler. Mais d’autres sont privés de droits.
J’ai changé de regard sur moi quand j’ai commencé à travailler. J’ai arrêté de dire : « Je suis un réfugié. »
Pour des personnes, il y a un danger de mort, comme pour moi en Syrie ; mais, pour certains, il n’y a pas trop de danger : ces différences influent sur leur demande. Parfois, les gens ne sont pas d’accord avec les décisions prises. En fait, ce qu’ils veulent, c’est avoir des papiers. Il y a différentes cartes de séjour, mais ils réfléchissent en fonction de combien de temps ils vont rester en France. Après, il y a bien des critères selon l’État français, et ils sont difficiles à comprendre.
J’ai changé de regard sur moi quand j’ai commencé à travailler. J’ai arrêté de dire : « Je suis un réfugié. » Et les autres ont commencé à me voir comme une personne indépendante, normale. Avant, ils disaient : « Adil, c’est un demandeur d’asile. » Toujours. C’était fatigant. Si quelqu’un me demande : « Vous êtes réfugié ou demandeur d’asile ? » Eh bien, oui, c’est ma situation. Et moi, je me pensais toujours comme un demandeur d’asile, un réfugié. Avec le travail, j’ai commencé à me considérer comme une personne indépendante. Quand je suis sorti un peu de l’ambiance des associations, j’ai commencé le travail et à sortir vraiment de l’image du réfugié ou du demandeur d’asile.
L’image du réfugié, c’est quelque chose de normal au moment où je le suis effectivement. L’image de réfugié, ou l’ambiance où on parle beaucoup de réfugiés, c’était positif, pendant un certain temps, dans ma mémoire, dans ma tête. Quelquefois, ça peut aussi devenir très négatif. Mais, d’un autre côté, j’ai aussi appris le français, j’ai rencontré plein de monde et ça, c’était positif.
En 2006, des centaines de migrants dormaient dans la rue, au Mali. Les gens ne pouvaient plus avancer vers l’Europe, parce que les frontières commencent aujourd’hui au sud de l’Algérie. Mais, sans moyens, les gens ne pouvaient pas non plus retourner chez eux. Sans compter la honte de revenir au pays. Tant de personnes avaient fait déjà cinq ou dix ans dans leur parcours migratoire. Avec l’Association des refoulés d’Afrique centrale au Mali (Aracem), nous pouvions héberger et nourrir des personnes pendant une à deux semaines, leur offrir des soins et des vêtements, permettre aux mineurs de se scolariser (des familles entières font le voyage). Et nous essayions de permettre à ceux qui désirent retourner dans leur pays de rentrer. Je suis venu plusieurs fois en France pour des colloques avec ces organisations.
L’idée, c’est d’avoir un métier et, ainsi, d’être acteur de son propre développement.
Ensuite, je suis arrivé en France avec un visa d’un mois en 2012. Un ami du Gers m’a fait un contrat de travail. J’ai été charpentier dans son entreprise pendant un an et demi. Et ce contrat m’a permis d’obtenir un titre de séjour d’un an. Cette expérience m’a permis de comprendre qu’aujourd’hui un jeune qui fait le choix de partir de son pays pour chercher la vie, s’il a un métier, est capable de s’insérer. Sans cela, on reste des personnes sans papiers qui travaillent au noir et qui attendent désespérément un CDI pour faire une demande de carte de séjour, qui va peut-être être rejetée.
Alors je suis retourné au Cameroun, et j’y ai monté l’association Botnem. C’est mon projet de vie : la construction d’un centre de formation professionnelle solidaire. Cela part des constats que j’ai faits en France en discutant avec d’autres immigrants. Certains savent parler français, d’autres ont fait des études secondaires mais, au niveau professionnel, beaucoup ne savent rien faire. L’insertion professionnelle, ça passe par un métier. Tout le monde n’aura pas la chance de devenir PDG ! Mais on recherche aujourd’hui un maçon, un électricien, un boulanger, un carreleur… J’ai pris contact, ici en France, avec certains CFA (centres de formation des apprentis) pour essayer de repartir au Cameroun former les jeunes aux métiers du bâtiment. L’idée, c’est d’avoir un métier et, ainsi, d’être acteur de son propre développement. Si j’ai un métier, je peux décider de travailler dans mon pays ou partir dans un pays occidental ou dans un autre pays africain.
Il faut le dire aussi, l’Afrique a besoin de se développer. Et nous, aujourd’hui, nous sommes reconnus comme la diaspora africaine, lorsque nous retournons dans nos pays d’origine. Le défi dans le bâtiment en Afrique, c’est qu’aujourd’hui, ce sont les entreprises chinoises et portugaises qui sont installées sur le marché. Et elles ne recrutent pas des locaux, parce qu’ils n’ont pas les qualifications de base. Donc l’idée, c’est de pouvoir former des personnes. On n’a pas besoin de coopérants mais d’artisans qualifiés sur ces métiers qui iront en Afrique former une quinzaine de personnes qui, à leur tour, pourront dispenser ces cours. L’idée du projet n’est pas de sédentariser les jeunes, ni de les lancer dans un nomadisme migratoire, mais de leur donner le choix.
Laisser un demandeur d’asile pendant des années sans lui permettre de travailler, ça le tue à petit feu.
La migration économique n’est pas encore reconnue et n’a pas d’attribution, nulle part. On est donc obligé et contraint – c’est ce qu’on appelle des techniques d’adaptation – de commencer par cette demande d’asile pour pouvoir aboutir plus tard à une reconnaissance en tant que migrant économique. En fait, il n’y a aucun statut de migrant économique : laisser un demandeur d’asile pendant des années sans lui permettre de travailler, ça le tue à petit feu, parce que toutes ses pensées se tournent vers son père, sa femme, ses enfants ou sa famille restés au pays et qu’il ne peut pas soutenir. Je pense qu’on n’aide personne ainsi.
Alors la mise en place d’un titre de séjour adapté permettrait aux jeunes de venir voir la réalité en face, de se former puis de retourner développer leur pays. Il ne faut pas se leurrer, l’Europe ne développera pas l’Afrique à sa place. L’Afrique sera développée par des Africains. Mais on a besoin de connaissances qu’on pourra ramener sur nos territoires. Aujourd’hui, je demande de mettre en place des mécanismes pour cela. La mise en place de visas ou de cartes de séjour de type « circulaire » permettrait à nos pays de résoudre tous ces problèmes de morts dans la mer ou dans les déserts et rendrait la vie plus humaine.
Propos recueillis pas Jean-Marie Carrière