
Les langages de la transition
La Revue Projet, c'est...
Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.

Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.
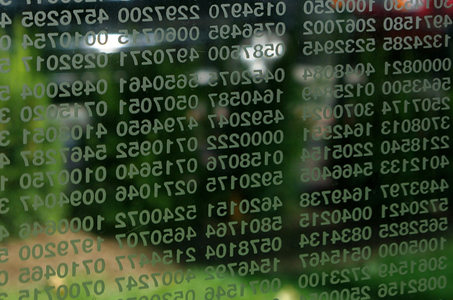
Depuis la fin des années 19901, des acteurs toujours plus nombreux se mobilisent en faveur d’indicateurs venant compléter et supplanter le Pib (produit intérieur brut) et sa croissance, symboliquement et politiquement. Ils mettent en avant des indicateurs de finalités sociales et écologiques, de bien-être individuel et collectif ou de « soutenabilité ». Ont-ils gagné la partie ? Le mouvement peut-il voler de ses propres ailes, au sein d’institutions désormais acquises à leurs idées, sans intervention des citoyens ?
Un bilan des multiples initiatives officielles émanant des plus grandes institutions nationales et internationales depuis 2007 pourrait le laisser croire. À bien des égards, il s’agit d’une victoire de la société civile, qui a su trouver des alliés dans un contexte qui s’y prêtait. Mais cette avancée est en réalité très contrastée. Et l’on est encore loin d’un usage courant de ces nouveaux repères dans la gestion des affaires publiques. De même, ils restent marginaux dans l’information délivrée par les grands médias. Si les nouveaux indicateurs se multiplient, ils restent périphériques. Certains semblent avoir été inventés pour laisser penser que l’on change de cap, alors qu’il n’en est rien. La récupération régressive et le greenwashing des indicateurs existent aussi.
Sur le plan international, les choses s’accélèrent à partir de 2007. Rien de marquant ne s’était produit depuis les travaux pionniers, dès 1990, du Pnud (Programme des Nations unies pour le développement), dont l’IDH2 (indicateur de développement humain) avait eu un succès mondial. Or cet indicateur avait été explicitement conçu pour contrebalancer les idées de la Banque mondiale et du FMI. Pour ces institutions, le « développement » est plus ou moins synonyme de croissance du Pib, en priorité, et à tout prix. En 2007, la Commission européenne organise, avec certaines ONG, une vaste conférence internationale : « Au-delà du Pib ». Ses conclusions ne manquent pas de radicalité. Dans la foulée, l’OCDE lance un programme ambitieux et tient à son tour à Istanbul, fin 2007, un Forum mondial qui se conclut par une « déclaration » d’un grand intérêt.
Pour la Banque mondiale et le FMI, le « développement » est synonyme de croissance du Pib, en priorité, et à tout prix.
En janvier 2008, à la surprise générale, Nicolas Sarkozy nomme une commission internationale, très majoritairement anglo-saxonne, dont il confie la présidence à l’économiste américain Joseph Stiglitz, secondé par Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi. Leur mission : « Déterminer les limites du Pib en tant qu’indicateur des performances économiques et du progrès social […] pour aboutir à des indicateurs de progrès social plus pertinents. » Les conclusions de cette commission, composée presque exclusivement d’économistes et fermée au dialogue avec la société civile, sont ambiguës3. Mais sa forte remise en cause de la prééminence du Pib comme indicateur de progrès constitue une consécration officielle pour les avocats d’autres indicateurs. Sans être pris en charge par de grandes institutions, certains indicateurs ont fait une vive percée internationale en étant relayés par la société civile (ONG et associations souvent liées à des chercheurs). C’est le cas de l’indicateur de santé sociale4, de l’empreinte écologique, indicateur de pression écologique très parlant, et plus récemment de l’empreinte eau.
En France, les initiatives nationales et territoriales se multiplient elles aussi au cours des dernières années à la suite de travaux pionniers de la région Nord-Pas-de-Calais dès 2003. Le Cese (Conseil économique, social et environnemental) se saisit quant à lui de ces questions à deux reprises, en 2009 et 2012. L’Insee n’est pas en reste.
Depuis 2010-2011, d’autres indicateurs ont vu le jour. Dans bien des cas, on assiste soit à un affadissement considérable de la portée critique des indicateurs alternatifs, soit à des tentatives de récupération régressive ou de greenwashing au service du « Business as usual ». Voici les trois principaux exemples.
L’OCDE lance en 2011 un indicateur composite de « mieux vivre » faisant la moyenne de dix-neuf variables supposées refléter le bien-être. Il repose sur une vision individualiste et asociale du bien-être : celle de l’OCDE. Plusieurs des variables reflètent le « toujours plus » matériel, induisant l’idée que toujours plus, c’est toujours mieux. Toujours plus de pièces par occupant, toujours plus de revenus et de patrimoine financier : cela relève-t-il du bien-être au même titre que le fait de vivre avec un air peu pollué ou en pouvant compter sur des proches ? Plus problématique encore : on ne trouve aucun indicateur de pauvreté, d’exclusion, de chômage ou d’inégalité et seule une variable prend en compte l’environnement. Si l’on avait introduit ne serait-ce que deux ou trois de ces critères dans l’indicateur, le classement des pays anglo-saxons aurait été déplorable, comme il l’est dans l’indicateur de pauvreté humaine du Pnud.
Avec cet indicateur, le classement des pays est d’ailleurs assez fortement corrélé au classement selon le Pib par habitant, façon comme une autre de préserver ce dernier critère. Cela n’a rien d’étonnant : dès lors qu’on choisit de mettre dans l’indicateur composite plusieurs variables liées au Pib par habitant (taille des habitations par occupant, existence de sanitaires, revenu, patrimoine financier), on augmente fortement la probabilité que l’indicateur composite (la « moyenne ») soit corrélé au Pib par habitant.
Le choix des critères, donc la vision du bien-vivre, n’est pas mis en débat.
Enfin, l’OCDE nous présente cet indicateur comme ouvert au débat démocratique car, sur son site, chacun peut choisir la pondération affectée à chacune des dix-neuf variables et obtenir un indicateur « personnalisé ». L’exercice peut être amusant, mais il est largement vain. Le plus important, le choix des critères, donc la vision du bien-vivre, n’est pas mis en débat. Une telle méthode ne peut contribuer à construire une convention partagée du bien-vivre, contrairement à ce qui s’avère possible, par exemple, dans des conférences citoyennes où l’on délibère des « richesses fondamentales » d’une société.
La Banque mondiale a, de son côté, tenté de promouvoir l’épargne nette ajustée (ENA), visant à évaluer le caractère soutenable ou non de la trajectoire de chaque pays sur la base de ses flux d’épargne en « capitaux » économiques, humains et naturels. Il suffit de savoir que, selon cet indicateur (qui additionne l’épargne économique, l’épargne en capital naturel et en capital humain, le tout exprimé en dollars), la Chine suivrait une trajectoire remarquablement soutenable pour émettre des doutes sérieux sur son bien-fondé. Or on dispose, pour ce pays comme pour d’autres, d’une batterie d’indicateurs clairs de pression écologique, d’émissions de gaz à effet de serre, d’épuisement des ressources en eau et des terres arables, mais aussi d’explosion des inégalités. Tous montrent, ce que les dirigeants chinois savent parfaitement, que ce pays est entré dans une crise écologique et sociale qui s’approfondit, selon une tendance opposée à ce qu’indique l’ENA.
En juin 2012, les Nations unies, via le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), ont emboîté le pas avec un indicateur proche, l’Inclusive Wealth Index (IWI), ambitionnant de calculer non plus les flux d’épargne globale, mais les stocks des mêmes capitaux. Le collectif Fair rejette une telle approche (cf. encadré).
On pourrait ajouter à ces exemples d’indicateurs – dont on se demande s’ils sont faits pour éclairer les enjeux ou pour les masquer –, la mode des indicateurs subjectifs de « bonheur », issus d’enquêtes où l’on demande aux personnes si elles s’estiment heureuses ou satisfaites de leur vie. Ils fournissent, certes, des informations à verser au débat, mais leur interprétation en vue de comparaisons dans le temps ou entre pays est très délicate. Leur usage au service de politiques du bien-vivre est hautement problématique. Ils sont à la démocratie des indicateurs ce que les sondages sont à la démocratie tout court.
Ce bref historique de la décennie écoulée suggère que se jouent autour des indicateurs les plus visibles et les plus diffusés des enjeux qui vont bien au-delà des chiffres, de leur sérieux, de leur transparence. Autant de critères non négligeables mais finalement non décisifs. Ce sont des valeurs de société et des visions de l’avenir qui s’affrontent et (rarement) dialoguent. L’économiste Isabelle Cassiers l’exprime ainsi :
« Parmi les forces qui poussent vers un ‘au-delà du Pib’, il semble utile d’en distinguer au moins deux. La première s’est saisi des indicateurs depuis longtemps… Son mobile est le profit. L’indicateur est aujourd’hui pour elle un outil de gouvernance, c’est-à-dire un mode d’extension d’une logique managériale à des sphères de plus en plus diversifiées de l’activité humaine. Dans un monde globalisé, gouverner par indicateurs permet d’étendre l’emprise d’une logique univoque. Dans un monde déshumanisé, l’usage d’indicateurs permet de rendre anonyme la pression exercée à tous les niveaux pour plus de performance et de rendement. Cette tendance ne voit dans l’éducation que la constitution d’un capital humain productif et dans l’écosystème un capital naturel à exploiter.
La deuxième force est plus hétérogène. Ce qui l’unifie potentiellement, c’est une immense aspiration à déployer des valeurs plus humaines, plus généreuses, plus viables que celles dictées par la quête de profit. Elle donne priorité aux résultats en termes humains ou écologiques. Elle est, par nature, plus portée au dialogue, à la rencontre et à la délibération qu’à la quantification d’objectifs et de performances. Mais elle aurait bien tort de ne pas se saisir du débat sur les indicateurs comme d’un cheval de Troie5. »
Cette floraison d’indicateurs ressemble à s’y méprendre à une hyperinflation. Si la croissance économique finit par avoir des rendements décroissants en bien-être, celle du nombre d’indicateurs alternatifs ou pseudo-alternatifs pourrait conduire à brouiller les pistes. Évoquons brièvement ce risque de « fuite en avant », en suivant Arnaud du Crest6 : « Faute de maîtriser la consommation d’énergie ou la criminalité, on les mesure le plus finement possible. Faute de décider, on demande des indicateurs plus récents, plus précis… Il faudrait privilégier, sans inflation, des indicateurs (et des processus démocratiques pour les obtenir) liés à des politiques de transformation d’un monde en crise, sans verser dans aucun nouveau fétichisme des indicateurs. Ces derniers sont des boussoles parmi d’autres, ni plus, ni moins. Autant nous équiper de celles qui peuvent nous indiquer un chemin humain et durable. »
Ces considérations interrogent les usages des indicateurs alternatifs réellement « critiques », ceux qui participent d’une remise en cause de l’ordre économique et social existant. En simplifiant, on peut distinguer deux catégories, qui se recouvrent parfois mais avec des visées distinctes. D’une part, des indicateurs d’alerte, de sensibilisation, d’éducation populaire sur de grands enjeux de société, comme l’IDH, l’empreinte écologique, les indicateurs de pauvreté ou de grande richesse. D’autre part, des indicateurs établissant des objectifs de politiques publiques et permettant d’en suivre les étapes, comme les Objectifs du millénaire de l’Onu, les objectifs de réduction de la pauvreté monétaire, de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Cette dualité des usages peut aider à traiter le problème que pose ainsi Philippe Frémeaux7 : « Il n’aura servi à rien de réfléchir à de nouveaux indicateurs si les priorités de l’action publique demeurent inchangées. Un exemple : une société qui cherche à maximiser le bien-être de ses membres devrait avoir d’autres priorités que de travailler plus pour gagner plus… »
Or le degré effectif d’usage des indicateurs alternatifs « critiques » diffère le plus souvent selon qu’on envisage leur première ou leur deuxième « fonction ». Comme outils de pilotage de l’action publique ou de gouvernance, on n’a pratiquement pas d’exemple de pays ayant institué des indicateurs vraiment alternatifs au plus haut niveau politique et médiatique, à l’exception – quelque peu exotique, bien qu’intéressante – du Bhoutan. En revanche, comme outils de prise de conscience d’enjeux nouveaux, de mobilisation ou de contestation, ils sont devenus omniprésents, au point que certains se demandent si la société civile ne participe pas elle aussi à la quantophrénie8 ambiante, la frénésie du chiffre.
« Quantifier, c’est produire du savoir, donc acquérir du pouvoir. » Les « statactivistes »
Pourtant, le recours à certains chiffres et indicateurs bien choisis s’avère souvent décisif pour les « activistes », pour reprendre un terme employé par les « statactivistes », collectif français défendant l’idée de statistiques citoyennes, émancipatrices, mises au point sur un mode pleinement délibératif9. Leur analyse est la suivante : « Aujourd’hui, les statistiques ont mauvaise presse. Elles glacent les relations humaines ; elles reposent sur un fichage de la société ; elles nous évaluent sans cesse, nous assignant des objectifs à atteindre en nous engageant dans une course à laquelle nous n’avons pas demandé de participer. Les statistiques sont pensées comme un moyen de contrôle, pire, de domination. Certains réagissent en les rejetant en bloc… Mais ce faisant, ils laissent le monopole de cet instrument aux puissants et jettent hélas le bébé avec l’eau du bain… Quantifier, c’est produire du savoir, donc acquérir du pouvoir ». Mais la question est alors de savoir comment, et avec qui.
L’enjeu des « nouveaux indicateurs » consiste à se doter collectivement de repères qui « indiquent » de bons caps, associés à des finalités sociales et écologiques désirables. Mais qui est légitime pour définir ces critères, et donc les indicateurs, lorsque la quantification s’avère pertinente ?
Pour l’instant, les gouvernants répondent : des experts. Essentiellement des économistes et des statisticiens, car, nous dit-on, il s’agit de questions d’une haute technicité. Il est vrai que la mise au point d’indicateurs exige un minimum de technique et de recherche. Mais, d’une part, l’essentiel de ces techniques est accessible moyennant un peu de formation (comme on peut le faire dans des conférences citoyennes), et, d’autre part, les principaux choix ne sont pas techniques. Ils relèvent de visions du « progrès » ou du bien-vivre, autant de choses que les citoyens portent et que leurs associations défendent. Les plus légitimes pour fixer des caps ce sont eux, moyennant délibérations et dispositifs de pleine participation, moyennant aussi un dialogue équilibré avec ceux des experts et des élus qui acceptent l’ouverture aux savoirs citoyens.
Voici ce qu’écrit la sociologue Hélène Combe10, qui a animé en 2011-2012 une vaste expérience dans la région des Pays-de-la-Loire : « Entrer sur le terrain des indicateurs conduit généralement à la question de l’expertise, la complexité supposée du sujet renvoyant dos à dos les maestros du chiffre et de la technique et les novices (les autres). Or, chacun est concerné par les indicateurs, parce que nombre d’entre eux parlent de nous, et parce que leur utilisation exerce une influence considérable sur notre vie… Dans le domaine des indicateurs, l’opacité technique n’est pas inéluctable. Le débat public sur le contenu et la méthode de lecture des indicateurs est possible… Faute de quoi, quelques-uns pourraient décider pour tous et du cap et de la boussole. »
L’enjeu central de la problématique des nouveaux indicateurs est celui de la démocratie dans la définition collective de ce qui compte le plus, de ce qu’il convient de compter (ou non), et seulement ensuite des façons de compter. Cela passe par le croisement organisé des savoirs spécialisés et des savoirs généralistes des citoyens.
Pour aller plus loin :
Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi, « Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social », 14 septembre 2009.
1 En 1999, Dominique Méda publie Qu’est-ce que la richesse ?, réédité sous une forme un peu abrégée en 2008 sous le titre Au-delà du Pib. Pour une autre mesure de la richesse, Flammarion. En 2002, Patrick Viveret remet, en concertation avec un groupe pluraliste, un rapport « Reconsidérer la richesse », publié aux éditions de L’Aube (2004, rééd. 2010).
2 Une histoire de l’IDH, avec ses protagonistes et leurs débats, est racontée par Jean Fabre, qui fut longtemps directeur adjoint du Pnud dans La richesse autrement, Alternatives économiques, hors série poche, n° 48, mars 2011.
3 Voir l’analyse de Fair dans La richesse autrement, op. cit.
4 Voir Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice, Les nouveaux indicateurs de richesse, La Découverte, « Repères », 2012 (3e édition actualisée).
5 La richesse autrement, op. cit.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Terme que l’on doit au sociologue américain Pitirim Alexandrovich Sorokin (1889-1968). Cf. F. Jany-Catrice, La performance totale : nouvel esprit du capitalisme ?, Septentrion, 2012.
9 http://statactivisme.savoirscommuns.org/
10 La richesse autrement, op. cit.
L’indicateur global de richesses des Nations unies est insoutenable
Communiqué de Fair, 21 juin 2012 (extraits)
« Ce projet aboutit à des résultats aberrants si toutefois on veut faire de l’IWI (Inclusive Wealth Index), ce que le rapport prétend, un indicateur global de ‘soutenabilité’. Avec l’IWI, le pays qui détient le plus haut taux de croissance de sa soutenabilité globale est… la Chine. Et tous les pays riches évoluent paisiblement vers la soutenabilité globale, y compris les États-Unis. Or on sait que, pour ces pays et pour bien d’autres, tous les vrais indicateurs de pression écologique et de santé sociale sont dans le rouge et reflètent une dégradation considérable.
Les auteurs parviennent à de tels résultats par des méthodes survalorisant fortement les ‘prix’ des ressources potentiellement marchandes (extractives par exemples) et du ‘capital humain’, au sens des économistes : la part des richesses naturelles dans le patrimoine IWI du Royaume-Uni ne serait que de 1 % (1,5 % pour la France)…
Cette méthode suppose la possibilité de compenser n’importe quelle dégradation du ‘capital nature’ par la progression du capital humain ou du capital productif. Cela revient à négliger les seuils critiques de dégradation de l’environnement, voire du lien social.
Enfin, ces calculs excluent aussi bien les inégalités que les risques écologiques majeurs : ‘la régulation du climat, celle des inondations, les sols fertiles, la biodiversité, l’eau potable… n’ont pas été retenus dans cette mesure de la richesse’. Tout ce qui compte le plus sur le plan écologique et social n’entre pas dans les calculs ! »