
Les langages de la transition
La Revue Projet, c'est...
Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.

Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.
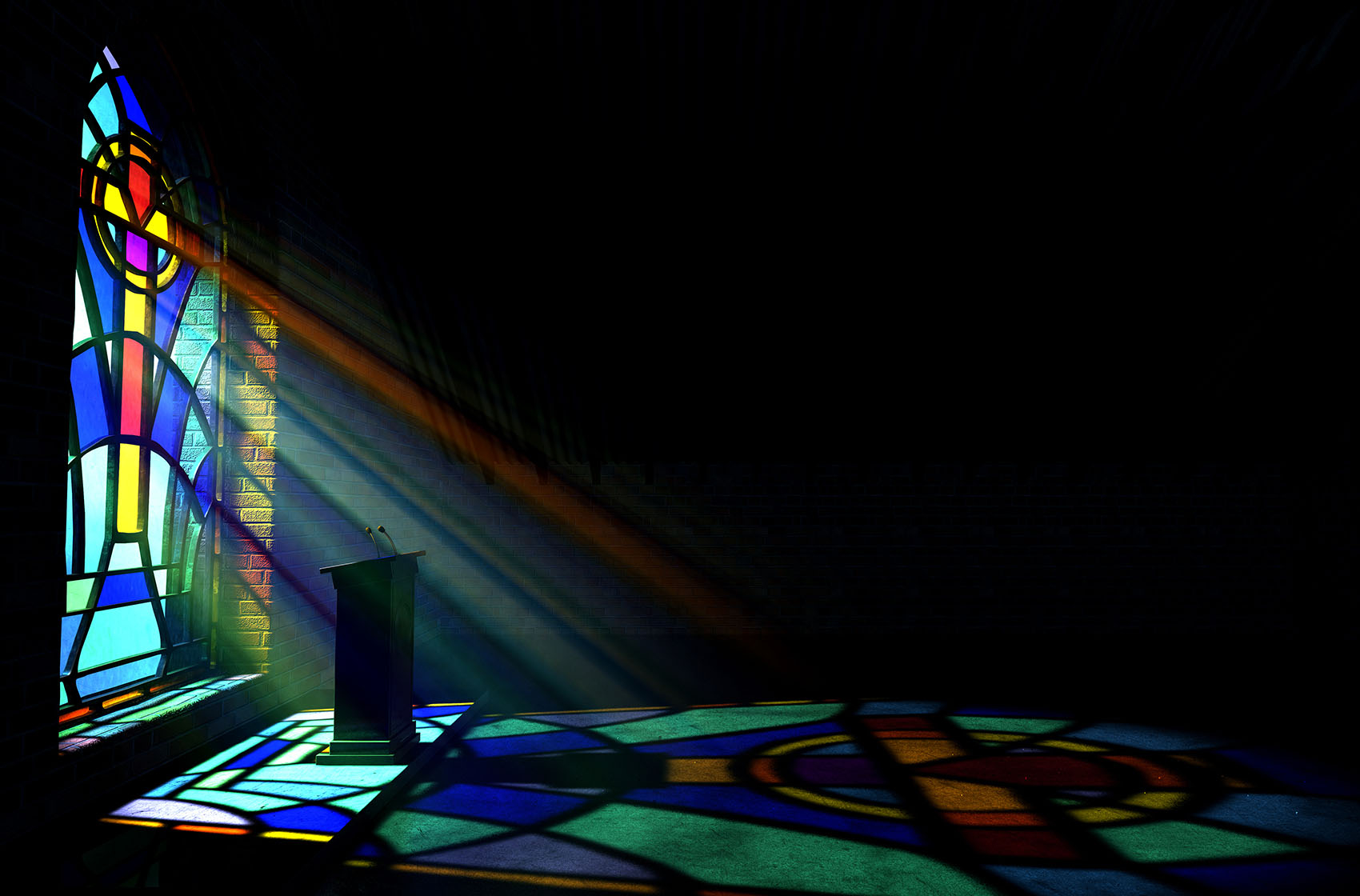
Un an après la remise du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), la succession de révélations accablantes concernant de hauts dignitaires accentue le discrédit sur le fonctionnement de l’Église catholique. Comment rétablir la confiance ? Elle exige, plus qu’un aggiornamento, une véritable révolution copernicienne, notamment sur deux points au cœur de ses égarements actuels : la culture du secret et le cléricalisme.
Les deux instances mises en place après la Ciase sont désormais opérationnelles : l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (l’Inirr) et la Commission reconnaissance et réparation pour les victimes de religieux et de religieuses (CRR). Mais aucune des deux ne dispose pour le moment des moyens humains et financiers suffisants aux tâches qui leur ont été confiées ; tâches qui restent d’ailleurs très peu connues dans les diocèses.
Ce dispositif apparaît pourtant essentiel. Le juriste français Louis Joinet, auteur d’un rapport de référence à l’Onu en 1997, propose quatre piliers pour reconstruire une société sur des bases démocratiques après un crime de masse : le « droit de savoir », le « droit à la justice », le « droit à réparation » et la « réforme des institutions ». Les victimes, placées au centre de ce processus, sont considérées comme sujets (et non objets) de droit. Une mission à laquelle s’attèlent courageusement l’Inirr et la CRR.
L’exercice du pouvoir dans l’Église doit être radicalement changé pour éviter que se renouvellent de tels abus.
L’Église ne peut se relever que si elle se réforme en profondeur. La crise des abus sexuels est bien plus large que la pédocriminalité. L’heure n’est plus aux tergiversations : les évêques ne peuvent plus rester dans l’entre-soi et la « solidarité » de corps.
Il ne s’agit pas seulement d’ouvrir des espaces de contre-pouvoir pour éviter que se renouvellent de tels abus, mais d’instaurer une nouvelle forme de gouvernance, intégrant sur un pied d’égalité clercs et laïcs, hommes et femmes.
C’est donc bien l’exercice du pouvoir dans l’Église qui doit être radicalement changé, pour avancer vers une vraie représentativité et développer la coresponsabilité. Un problème systémique suppose un changement systémique.
L’Église d’outre-Rhin est déjà engagée sur cette voie, à travers un processus de réflexion original, Chemin synodal, qui accorde aux laïcs la possibilité d’un co-pilotage. En novembre dernier, lors de leur visite à Rome, les évêques allemands ont présenté d’audacieuses propositions de réformes, mettant ainsi en lumière leurs points de désaccords avec le Vatican.
En France, Promesses d’Église, un collectif d’organisations catholiques, a adressé en mai dernier une contribution à la Conférence des évêques de France. Alors qu’une opposition demeure entre un courant conservateur et un courant progressiste parmi les croyants, et y compris dans le corps épiscopal, reste à savoir si cette démarche synodale permettra d’amorcer un dialogue constructif en prise avec la gravité de la situation.