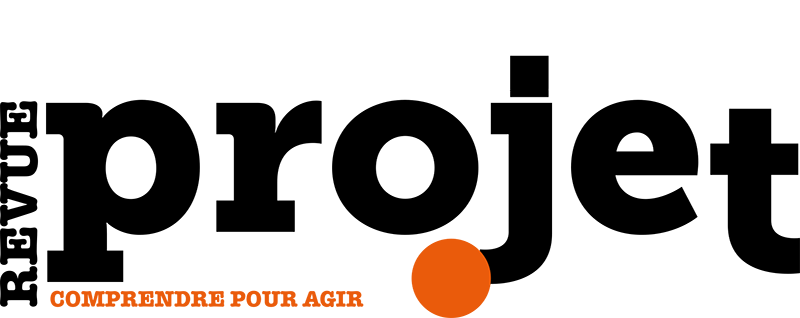Regards critiques sur la mondialisation : Le gouvernement du monde et La grande perturbation
Jean-François Bayart et Zaki LaïdiFaut-il dire mondialisation ou globalisation ? J.-F. Bayart opte pour le deuxième terme qui lui semble mieux traduire l’expérience historique de « compression du temps et de l’espace »et la conscience qu’on en a. Le moins qu’on puisse dire est que la mondialisation est composée d’éléments fort disparates et qu’elle ne fait guère système. Il n’est donc pas étonnant qu’elle soit anxiogène et donne lieu à des interprétations contrastées.
▶ C’est au début du xixe siècle que J.- F. Bayart situe les prémices d’un phénomène qui n’a pas cessé de s’amplifier. Z. Laïdi admet, lui aussi, que la mondialisation a commencé par l’interpénétration des économies, déjà étroite en 1913. Mais la « grande perturbation » est pour lui plus récente. Elle commence en 1980, succédant à une reprise en mains de l’économie par les Etats, après la crise de 1929 et la seconde guerre mondiale. Pour autant, les deux auteurs s’accordent à penser que la mondialisation est loin d’être « globale ».
▶ Zaki Laïdi met en garde contre l’idée d’un affaissement des Etats sous les coups de boutoir de la mondialisation. Car, bien entendu, il subsiste de très grandes inégalités entre les Etats, et la mondialisation a pour les plus faibles d’entre eux des conséquences négatives et positives. Les plus solides, eux, gardent d’importants pouvoirs non seulement régaliens mais aussi en matière de politiques économiques, sociales et culturelles.
▶ Certes, la notion de souveraineté indivisible et sans limites, telle que Jean Bodin la définissait au xvie siècle, n’est plus tenable aujourd’hui. Elle reposait sur une conception du politique, au-dessus de tout parce qu’il était tout. Aujourd’hui, l’Etat est appelé à coopérer avec d’autres acteurs présents dans l’espace public : le marché, dont les dimensions excèdent celles d’un Etat ; la société civile nationale, qui tend à devenir internationale. Face à des enjeux planétaires – l’environnement, l’accès à l’eau, les pandémies –, la souveraineté d’un Etat est appelée à composer avec celle des autres. Elle ne disparaît pas, mais ne peut plus être considérée comme absolue.
▶ J.- F. Bayart, quant à lui, n’hésite pas à dire que la globalisation est moteur de la formation de l’Etat. Né en Occident, ce mode d’organisation de la souveraineté s’est diffusé de par le monde en même temps que la globalisation progressait. La SDN comptait 29 adhérents, les signataires de la Charte de San Francisco étaient 51, il y a aujourd’hui environ 200 Etats dans le monde, dont 184 sont-membres des Nations unies. Parmi les nouveaux venus, beaucoup ne seraient, dit-on, que des quasi-Etats éphémères ? Le cas emblématique de l’Afrique subsaharienne invite à penser le contraire : les frontières héritées de la colonisation ont assez bien tenu.
▶ Pour Z. Laïdi, le mode de gouvernement convenant à la mondialisation serait celui de la gouvernance, combinant l’Etat, le marché et la société civile. Pourtant, J.- F. Bayart juge qu’il faut veiller à ce que ce mode d’organisation ne conduise pas à placer l’accent sur la délibération, plus que sur la décision et le pouvoir, au détriment du politique. Il préfère parler de gouvernementalité, un concept proposé par Michel Foucault pour désigner « une action qui s’exerce sur des actions ». Réfutant la position des souverainistes, Z. Laïdi souligne ce paradoxe : l’autorité sur un territoire donné est plus effective quand elle est partagée de manière conjointe par des Etats qui confient à un acteur supranational la responsabilité de son exercice, que lorsqu’elle reste circonscrite à un espace national sanctuarisé. Il critique aussi bien la position des libéraux qui croient à la capacité du marché de redistribuer les richesses crées dans le monde, en l’absence de mécanismes mondiaux de redistribution, que celle des altermondialistes qui dénoncent un darwinisme mondial implacable, largement démenti par la diversité des trajectoires nationales dans la mondialisation.
▶ Mais l’idée que la politique consiste à faire vivre ensemble des personnes et des collectivités qui ne s’entendent pas spontanément engendre deux modèles d’organisation. Le premier s’inspire de la conception de Hobbes pour qui l’on ne peut sortir de l’état de guerre de tous contre tous qu’en se donnant un pouvoir fort, un « Léviathan », capable d’exercer la coercition. C’est le modèle dont s’inspirent la Chine, des pays émergents d’Asie du Sud-Est et la Russie. Les Etats-Unis, démocrates en politique intérieure, mènent actuellement une politique extérieure hobbesienne, voire inspirée de Carl Schmitt (ne voulant connaître que des amis ou des ennemis). Tout autre est la conception à la base de la construction européenne. Elle vise à dépasser le potentiel de violence qui préside historiquement aux rapports entre Européens, comme en général entre les Etats, par la mise en place de normes communes – une tâche évidemment toujours difficile. Dans un monde où règne la violence et où beaucoup d’Etats, à commencer par le plus puissant, adhèrent au canon hobbesien, le modèle européen peut paraître bien faible. Pourtant, le modèle américain, si puissant, a-t-il la capacité d’établir la paix dans le monde ? Savoir de quel côté la mondialisation penchera est une question décisive aujourd’hui. Elle « se fait dans l’histoire », dit Zaki Laïdi ; le plus probable est que nous assistions à l’émergence d’un monde où coexisteront des fragments d’ordre et de régulation et des processus de dérégulation.
▶ J.- F. Bayart invite à compléter l’analyse par une compréhension plus fouillée des fondements sociaux de la globalisation. Il réfute l’idée qu’elle n’intéresserait que de petites élites intellectuelles ou technocratiques, à l’exclusion de tous les autres. Elle n’est pas nécessairement synonyme d’aliénation culturelle et de délitement social, suscitant pour tous à la fois des formes de soumission et des modes d’appropriation. A l’ère de la première mondialisation, celle de la colonisation, les colonisés n’ont pas seulement subi une domination. Ils ont acquis de nouveaux types de savoirs et de savoir faire. A leur contact, les colonisateurs ont eux-mêmes changé. Aujourd’hui, la globalisation induit dans tous les pays et dans tous les groupes sociaux un mode nouveau de rapport à soi, au corps, aux objets, comme de nouvelles attentes et de nouvelles formes d’activité en réseaux.
Faut-il dire mondialisation ou globalisation ? J.-F. Bayart opte pour le deuxième terme qui lui semble mieux traduire l’expérience historique de « compression du temps et de l’espace »et la conscience qu’on en a. Le moins qu’on puisse dire est que la mondialisation est composée d’éléments fort disparates et qu’elle ne fait guère système. Il n’est donc pas étonnant qu’elle soit anxiogène et donne lieu à des interprétations contrastées.
▶ C’est au début du xixe siècle que J.- F. Bayart situe les prémices d’un phénomène qui n’a pas cessé de s’amplifier. Z. Laïdi admet, lui aussi, que la mondialisation a commencé par l’interpénétration des économies, déjà étroite en 1913. Mais la « grande perturbation » est pour lui plus récente. Elle commence en 1980, succédant à une reprise en mains de l’économie par les Etats, après la crise de 1929 et la seconde guerre mondiale. Pour autant, les deux auteurs s’accordent à penser que la mondialisation est loin d’être « globale ».
▶ Zaki Laïdi met en garde contre l’idée d’un affaissement des Etats sous les coups de boutoir de la mondialisation. Car, bien entendu, il subsiste de très grandes inégalités entre les Etats, et la mondialisation a pour les plus faibles d’entre eux des conséquences négatives et positives. Les plus solides, eux, gardent d’importants pouvoirs non seulement régaliens mais aussi en matière de politiques économiques, sociales et culturelles.
▶ Certes, la notion de souveraineté indivisible et sans limites, telle que Jean Bodin la définissait au xvie siècle, n’est plus tenable aujourd’hui. Elle reposait sur une conception du politique, au-dessus de tout parce qu’il était tout. Aujourd’hui, l’Etat est appelé à coopérer avec d’autres acteurs présents dans l’espace public : le marché, dont les dimensions excèdent celles d’un Etat ; la société civile nationale, qui tend à devenir internationale. Face à des enjeux planétaires – l’environnement, l’accès à l’eau, les pandémies –, la souveraineté d’un Etat est appelée à composer avec celle des autres. Elle ne disparaît pas, mais ne peut plus être considérée comme absolue.
▶ J.- F. Bayart, quant à lui, n’hésite pas à dire que la globalisation est moteur de la formation de l’Etat. Né en Occident, ce mode d’organisation de la souveraineté s’est diffusé de par le monde en même temps que la globalisation progressait. La SDN comptait 29 adhérents, les signataires de la Charte de San Francisco étaient 51, il y a aujourd’hui environ 200 Etats dans le monde, dont 184 sont-membres des Nations unies. Parmi les nouveaux venus, beaucoup ne seraient, dit-on, que des quasi-Etats éphémères ? Le cas emblématique de l’Afrique subsaharienne invite à penser le contraire : les frontières héritées de la colonisation ont assez bien tenu.
▶ Pour Z. Laïdi, le mode de gouvernement convenant à la mondialisation serait celui de la gouvernance, combinant l’Etat, le marché et la société civile. Pourtant, J.- F. Bayart juge qu’il faut veiller à ce que ce mode d’organisation ne conduise pas à placer l’accent sur la délibération, plus que sur la décision et le pouvoir, au détriment du politique. Il préfère parler de gouvernementalité, un concept proposé par Michel Foucault pour désigner « une action qui s’exerce sur des actions ». Réfutant la position des souverainistes, Z. Laïdi souligne ce paradoxe : l’autorité sur un territoire donné est plus effective quand elle est partagée de manière conjointe par des Etats qui confient à un acteur supranational la responsabilité de son exercice, que lorsqu’elle reste circonscrite à un espace national sanctuarisé. Il critique aussi bien la position des libéraux qui croient à la capacité du marché de redistribuer les richesses crées dans le monde, en l’absence de mécanismes mondiaux de redistribution, que celle des altermondialistes qui dénoncent un darwinisme mondial implacable, largement démenti par la diversité des trajectoires nationales dans la mondialisation.
▶ Mais l’idée que la politique consiste à faire vivre ensemble des personnes et des collectivités qui ne s’entendent pas spontanément engendre deux modèles d’organisation. Le premier s’inspire de la conception de Hobbes pour qui l’on ne peut sortir de l’état de guerre de tous contre tous qu’en se donnant un pouvoir fort, un « Léviathan », capable d’exercer la coercition. C’est le modèle dont s’inspirent la Chine, des pays émergents d’Asie du Sud-Est et la Russie. Les Etats-Unis, démocrates en politique intérieure, mènent actuellement une politique extérieure hobbesienne, voire inspirée de Carl Schmitt (ne voulant connaître que des amis ou des ennemis). Tout autre est la conception à la base de la construction européenne. Elle vise à dépasser le potentiel de violence qui préside historiquement aux rapports entre Européens, comme en général entre les Etats, par la mise en place de normes communes – une tâche évidemment toujours difficile. Dans un monde où règne la violence et où beaucoup d’Etats, à commencer par le plus puissant, adhèrent au canon hobbesien, le modèle européen peut paraître bien faible. Pourtant, le modèle américain, si puissant, a-t-il la capacité d’établir la paix dans le monde ? Savoir de quel côté la mondialisation penchera est une question décisive aujourd’hui. Elle « se fait dans l’histoire », dit Zaki Laïdi ; le plus probable est que nous assistions à l’émergence d’un monde où coexisteront des fragments d’ordre et de régulation et des processus de dérégulation.
▶ J.- F. Bayart invite à compléter l’analyse par une compréhension plus fouillée des fondements sociaux de la globalisation. Il réfute l’idée qu’elle n’intéresserait que de petites élites intellectuelles ou technocratiques, à l’exclusion de tous les autres. Elle n’est pas nécessairement synonyme d’aliénation culturelle et de délitement social, suscitant pour tous à la fois des formes de soumission et des modes d’appropriation. A l’ère de la première mondialisation, celle de la colonisation, les colonisés n’ont pas seulement subi une domination. Ils ont acquis de nouveaux types de savoirs et de savoir faire. A leur contact, les colonisateurs ont eux-mêmes changé. Aujourd’hui, la globalisation induit dans tous les pays et dans tous les groupes sociaux un mode nouveau de rapport à soi, au corps, aux objets, comme de nouvelles attentes et de nouvelles formes d’activité en réseaux.
1er mai 2004