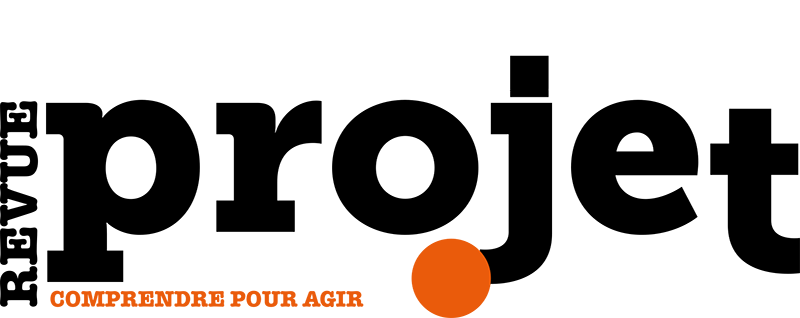Quand bien manger devient un luxe En finir avec la précarité alimentaire
Benjamin Sèze Les Éditions de l'Atelier, 2023, 176 p., 17 €Journaliste, spécialiste des questions sociales, Benjamin Sèze interroge dans ce premier essai un sujet brûlant, trop longtemps sous-estimé par les pouvoirs publics : la précarité alimentaire.
En 2020, la crise sanitaire frappait durement le pouvoir d’achat des plus pauvres. Deux ans plus tard, et alors que les blessures sont encore vives, la guerre en Ukraine et l’inflation s’ajoutent à ces difficultés, donnant à la situation un tour critique. Nombreux sont ceux qui, ayant déjà renoncé au superflu, n’ont d’autre choix que de réduire à la portion congrue leurs dépenses alimentaires.
« Huit millions de personnes sont aujourd’hui en situation d’insécurité alimentaire », assène d’emblée Benjamin Sèze, soit 11 % de la population. Une masse statistique contrainte de « se tourner vers une alimentation qui ne correspond pas à [ses] goûts, ne répond pas à [ses] besoins, et qui est souvent de mauvaise qualité ».
En treize chapitres, l’auteur couvre un grand nombre de sujets. Après avoir dressé le panorama d’une crise multifacettes, il recommande cinq grands axes pour répondre à l’urgence. Ce faisant, Benjamin Sèze dissipe les idées convenues, pose un constat circonstancié et en appelle à réorienter en profondeur les pratiques.
L’alimentation de qualité n’est accessible qu’à une petite minorité de Français aisés.
Aujourd’hui, nous dit-il, l’alimentation de qualité n’est accessible qu’à une petite minorité de Français aisés. La démocratiser est donc un enjeu de justice sociale, autant (si ce n’est plus) qu’un enjeu écologique. La conciliation de ces deux buts sert de fil rouge à l’ouvrage.
Le premier chapitre détricote les enjeux de la précarité alimentaire. Il alerte quant à l’urgence de la situation : les précaires dont nous parlons ne sont pas ceux qui cumulent les combines et les indemnités pour se maintenir à flot ; ce sont ceux qui sautent des repas parce qu’ils n’ont plus d’autre choix.
Certes, la médiatisation du phénomène fait office de « coup d’accélérateur », incitant les pouvoirs publics à se préoccuper de cette question – au moyen notamment d’une aide alimentaire plus conséquente. Mais ces injonctions éparses et les dispositifs d’urgence qui y répondent, ne sauraient suffire à endiguer une tendance de fond, un mal structurel et enlisé.
Aides insuffisantes
Dans son deuxième chapitre, Benjamin Sèze insiste sur l’insuffisance et l’inconséquence de l’aide alimentaire. Les besoins n’ont cessé de croître depuis l’établissement de cette politique publique dans les années 1980. Une extension quantitative qui en appelle une autre, qualitative : jadis réservée aux marginaux, l’aide alimentaire est aujourd’hui saisie par de nouveaux profils (étudiants, salariés, retraités, familles monoparentales, etc.).
Ces bénéficiaires, s’ils mangent, mangent mal. Leurs aliments sont peu variés, peu riches, de basse qualité, parfois avariés, rarement cuits ainsi que le démontre l’auteur dans son troisième chapitre. Surtout, avoir recours à l’aide alimentaire n’est pas anodin : nombre de bénéficiaires le vivent comme un constat d’échec, une souffrance psychologique que vient parfois aggraver le comportement paternaliste et méprisant de certains bénévoles. Le dilemme se pose, parfois en termes aigus : vaut-il mieux s’assurer un repas ou préserver sa dignité ?
Les pauvres n’ont pas des « goûts douteux », mais des moyens limités.
Pourtant, des huit millions de personnes en situation d’insécurité, toutes ne fréquentent pas l’aide alimentaire. Une partie parvient à garder le cap par la resquille et la débrouille : inscription des enfants aux cantines scolaires, achats discount, solidarité familiale ou amicale, etc. C’est de cette population que traite le quatrième chapitre.
Mais ces comportements ne sont pas sans incidences sur la santé. Ne consommer que des produits bas de gamme, souvent ultra-transformés, expose au risque de diabète, d’obésité et de maladies cardiovasculaires. Les pauvres n’ont pas des « goûts douteux », mais des moyens limités. L’auteur bat en brèche les clichés sur le « libre choix » des personnes pauvres de consommer des denrées de mauvaise qualité : 83 % des personnes interrogées lors d’une enquête du Secours Catholique se disent « préoccupées par les effets de leur alimentation sur leur santé ».
Face à ces enjeux de société, la réponse parfaite n’existe pas. L’auteur examine tout de même les différentes réflexions menées à ce sujet. Se pose tout d’abord la question de la rehausse des minima sociaux et des bas salaires. Face au préjugé tenace selon lequel les ménages précaires ne sauraient pas gérer leur argent, l’auteur rappelle qu’au contraire « dans la plupart des cas, lorsque les ressources manquent au foyer, la gestion du budget est d’une rigueur extrême ».
Retour d’expériences
Des exemples concrets viennent soutenir cette analyse, comme l’expérience du minimum social garanti mise en place par la mairie de Grande-Synthe (Hauts-de-France). Pour autant, la question du « manger mieux » doit encore être réglée par des politiques plus structurelles, comme la mise en place d’une offre d’alimentation durable qui permette une disponibilité en termes d’implantation dans les territoires.
Les grandes surfaces ne sont pas en reste en ce qui concerne la question de l’accessibilité. Une politique de marges particulièrement hautes pratiquée sur les fruits et légumes frais et les produits bio empêche une démocratisation pourtant essentielle. Pour autant, miser sur une évolution des pratiques est loin d’être absurde.
La solidarité reste bien le maître mot de la lutte contre la précarité alimentaire.
Yuna Chiffoleau, directrice de recherche en sociologie au département Sciences pour l’action et le développement d’INRAE, interrogée par l’auteur, en reste persuadée : les enseignes peuvent être poussées au changement, notamment sous la pression de la clientèle. Les initiatives comme l’application Yuka1 peuvent, à leur échelle, permettre au bio de s’émanciper de son statut de niche pour redevenir une alternative viable pour l’ensemble de la population.
La question de l’accessibilité est enfin analysée à travers les différentes formes qu’elle peut prendre. De la vente en circuit court (Amap2, marchés locaux, fermes, etc.) aux collaborations entre le monde agroalimentaire et les épiceries sociales et solidaires, en passant par l’idée novatrice d’une « sécurité alimentaire », des nouvelles intuitions visent à assurer conjointement un droit à l’alimentation, des droits aux producteurs et un respect de l’environnement.
Comme le rappelle très justement l’auteur, la solidarité reste bien le maître mot de la lutte contre la précarité alimentaire. À ce titre, les enseignements qu’on peut tirer du livre sont riches de sens et doivent nous inspirer à toujours garder en tête les mots du romancier Henry de Montherlant : « L’être humain est la proie de trois maladies chroniques et inguérissables : le besoin de nourriture, le besoin de sommeil et le besoin d’égards. »
1 Application mobile qui permet de scanner les produits alimentaires et cosmétiques en vue d’obtenir des informations détaillées sur l’impact d’un produit sur la santé.
2 Une Amap (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) est un partenariat entre un groupe de consommateurs et une ferme, basé sur un système de distribution de « paniers » de produits.
28 septembre 2023