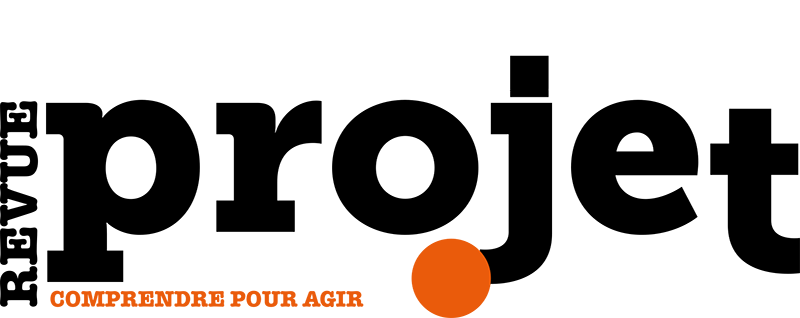Au-delà de la propriété
Benoît Borrits La Découverte, 2018, 248 p., 19 €Voilà de longues années que Benoît Borrits défend les coopératives et l’autogestion. C’est d’ailleurs par là qu’il commence, rappelant que c’est dans le mouvement coopératif que s’est élaborée la première tentative de dépassement de la propriété privée, le sujet de cet ouvrage. Mais pourquoi remettre en cause cette dernière ? D’abord parce que le modèle sociétal qui lui est corrélé montre ses limites (la crise sociale et écologique le rappelle tragiquement), mais aussi parce que, pour Borrits, aucune forme de propriété étatique n’a réussi. Lorsqu’il possède des moyens de production, l’État (et donc la couche sociale qui le contrôle) « se comporte toujours en propriétaire en monopolisant la fonction de décision ». La coopérative elle-même a tendance à s’autonomiser par rapport aux usagers. Faut-il alors en revenir à l’hypothèse de la non-propriété (à la suite de Proudhon, des communards, ou des révolutionnaires espagnols) ? L’auteur prouve par une analyse historique que cette voie-là non plus n’est pas féconde, et qu’il faut chercher la solution dans la gouvernance des entreprises.
L’autogestion comme point de départ, donc. Et puisque ce mouvement croît sensiblement ces dernières années (36 000 personnes employées en coopératives en 2005, 53 850 en 2016) et qu’il semble répondre aux nouvelles aspirations des employés au contrôle de leur travail, il convient en effet de s’y intéresser. Mais plutôt que les coopératives d’usagers ou de salariés (associations de producteurs ou d’ouvriers), l’auteur défend les coopératives multicollèges : « en associant usagers et travailleurs dans la gestion commune d’une entreprise, on permet […] un élargissement de la notion de service public au sens étymologique du terme : on ne produit plus pour mettre en valeur un capital mais pour répondre à un besoin social et l’ensemble des parties prenantes est impliqué dans ce processus ».
Contrairement au modèle de l’entreprise, où la totalité des fonds propres relève du régime de la propriété privée, les fonds propres de la forme coopérative sont constitués de parts sociales et de réserves impartageables – et seules les parts sociales relèvent de la propriété privée. L’angle, on le comprend bien vite, est post-marxiste (la possession des moyens de production doit être collective) et post-proudhonienne (la propriété, c’est le vol). Mais le mouvement coopératif ne suffit pas, puisqu’il « ne remet pas en cause le fondement du capital. Il se contente de le déclarer second en instituant des règles qui dérogent à sa vocation originelle » (dont celle par exemple d’une voix par personne plutôt qu’une voix par action). Ainsi, une propriété collective reste une propriété qui, ne concernant pas les non-membres de la coopérative, leur apparaît comme privée.
Malgré ces limites, Benoît Borrits prend le temps d’étudier l’apparition de l’autogestion dans les socialismes du XIXe siècle, qui proposent des initiatives innovantes. Les débats sont concentrés sur le rôle de l’État : peut-il devenir le cadre d’une propriété collective qui serait alors vraiment une alternative à la propriété privée sous toutes ses formes, y compris coopérative ? L’auteur met ainsi en lumière trois grandes approches. Celle d’une « étatisation de l’économie réalisant la propriété collective comme propriété étatique ». Celle « qui préconise la destruction de l’État et son remplacement par des conseils souverains de travailleurs organisés du bas vers le haut sans rien laisser subsister de la propriété ». Une tentative, enfin, « de constituer l’État comme cadre de réalisation d’une propriété collective dont la gestion serait confiée aux travailleurs, et éventuellement aux usagers, gestion qui devrait ouvrir la perspective du dépassement de l’État ».
Ces approches ont eu un écho dans les expériences mises en place au XXe siècle, en particulier la propriété collective par l’État en URSS, le modèle conseilliste de la révolution espagnole (dans lequel les travailleurs s’emparent des moyens de production et se coordonnent afin de définir un plan commun) et le modèle yougoslave d’autogestion des moyens de production par les travailleurs qui dura de 1950 aux années 1980. Trois expériences (URSS, Espagne, Yougoslavie), qui permettent à Borrits d’évaluer « la faisabilité de la vision conseilliste d’une planification du bas vers le haut », en tant que seules véritables tentatives de gommer la notion de propriété. Or le verdict est sans appel : ce furent trois échecs. Dans le cas yougoslave en particulier, le concept de « propriété sociale » définie comme « propriété de tous et de chacun » est « un véritable mystère qui ouvrira la voie de la privatisation ». Pour autant, Borrits souligne la création du statut juridique de « biens sociaux », qui sont l’objet d’une appropriation fondée sur le travail : « On approche ici la notion de non-propriété et d’appropriation développée sur la base de la coactivité. »
Cette notion de « biens sociaux » est reprise par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) dès 1966. Elle refuse toute justification du droit de propriété sur les moyens de production, pour prôner une « propriété sociale » et une gestion par les travailleurs eux-mêmes. Quant aux biens de production, ils doivent appartenir à tous.
L’approche autogestionnaire sera de même très présente lors des débats de Mai 68, ainsi qu’au sein du Parti socialiste unifié (PSU), puis du Programme commun (1972). Toute une aile de la CFDT et du PSU propose ainsi la notion de « dépropriation », pensée par Pierre Rosanvallon : non pas la substitution du propriétaire individuel des moyens de production par un propriétaire collectif, mais un vrai dépassement de la notion de propriété (privée comme étatique). Cependant, il n’y a là « aucune remise en cause de la propriété mais simplement un démembrement des droits de la propriété classique – usus, fructus, abusus – entre différents niveaux de décision ».
Benoît Borrits tourne alors son attention vers un autre phénomène, apparemment plus modeste : la socialisation des revenus au XXe siècle. L’invention des cotisations sociales n’est-elle pas un élément de contestation de la propriété ? Outre un salaire direct, l’entreprise paye des contributions diverses au travailleur (salaire différé) et à la société (salaire socialisé). Ne pourrait-on passer à « un niveau supérieur de socialisation du revenu », et déconnecter partiellement la rémunération des travailleurs du revenu généré par l’unité de production dans laquelle ils opèrent ? Borrits prône ainsi « une situation dans laquelle seule une partie des flux générés par l’unité de production sera directement appropriée par les travailleurs en poste, de quoi largement relativiser l’intérêt pour le maintien de rapports de propriété ».
Finalement, en se débarrassant des actionnaires et de leurs dividendes – les témoins aujourd’hui de la valeur d’une entreprise –, les seuls revenus primaires seraient ceux du travail. Quant au secteur non marchand (celui qui délivre des prestations gratuites), il bénéficierait d’un revenu socialisé, c’est-à-dire des cotisations sociales assises sur du travail valorisé dans la sphère marchande ! Et en encourageant cette logique, on augmentera toujours plus la part de biens ou de services rendus gratuitement, en socialisant une part toujours plus importante de la sphère marchande. Mais finalement, ce mouvement de rétrécissement de l’aire marchande ne conduit-il pas à une contradiction, en menant à une réduction de la base monétaire et une augmentation des prélèvements ? Contradiction qui ne peut se résoudre qu’avec la disparition de la monnaie et donc des prélèvements ! Tout est gratuit ! Plus personne n’est rémunéré ! L’auteur lui-même émet ses doutes quant à la réalisation d’un tel vœu…
Outre les cotisations, un deuxième dépassement avancé de la propriété des moyens de production concerne le financement de l’entreprise (son passif). La solution : permettre « un financement total des actifs de l’entreprise par endettement ». Sans fonds propres, c’est la notion même de propriété de moyens de production qui disparaît. À l’inverse d’un actionnaire, un créancier n’a aucun pouvoir sur l’entreprise et se contente d’être rémunéré et remboursé selon les termes d’un contrat.
Évidemment, cela implique un secteur bancaire socialisé, à l’exemple de l’Association internationale des banques coopératives (ICBA), qui financerait intégralement les unités de production. Plus de financement direct des entreprises, donc, mais seulement du financement intermédié réalisé par des établissements bancaires. Cette solution, longuement détaillée, peine pourtant quelque peu à convaincre. D’autant qu’à cette ambition s’ajoutent des phrases comme « Il est difficile de figer ce que sera l’entreprise de demain : elle sera ce que les citoyens en feront. ». On continue de s’interroger.
C’est ainsi cependant que Benoît Borrits pose les bases « d’une économie organisée sur le principe du commun plutôt que sur celui de la propriété ». Il articule plusieurs « communs » déjà visibles : un commun productif « dans lequel travailleurs et, souvent, usagers exercent ensemble le pouvoir » (les coopératives), en interaction avec des communs de socialisation des revenus et des communs de financement. C’est dans cette articulation que réside la force de l’ouvrage, audacieux par la visée dont il est porteur : un futur sans propriété, ni privée ni publique.
1er février 2019