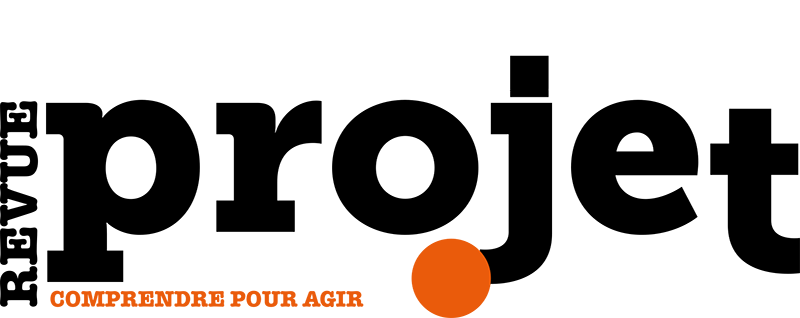Quelle démocratie ? tomes 1 et 2, Écrits politiques, 1945-1997, III et IV
Cornelius Castoriadis Éditions du Sandre, t. 1 : 694 p., t. 2 : 660 p., 2013, chaque tome : 32 €Sous le titre Quelle démocratie ?, ces quelque 1400 pages constituent les volumes III et IV des écrits politiques de Cornelius Castoriadis (1922-1997). Elles ont été précédées par La question du mouvement ouvrier, c’est-à-dire les deux premiers volumes des mêmes écrits et seront suivies par La société bureaucratique (tome V), puis Durant la guerre et autres récits (tome VI) et enfin Sur la dynamique du capitalisme et autres textes, suivi de L’Impérialisme et la guerre (tome VII).
Une fois lue la très éclairante introduction d’Enrique Escobar, qui met en perspective une pensée mouvante, intelligente, plus nuancée qu’on ne pourrait croire, le lecteur se trouve devant un discours militant d’une époque qui nous est devenue presque étrangère, car elle pense en termes de transformation possible et imminente de la société et qu’elle se débat d’abord avec la pensée de Karl Marx. Mais qu’est-ce que Castoriadis a à nous dire aujourd’hui ? D’abord la compréhension de ce qu’est une théorie philosophico-politique : il ne peut y avoir de théorie fermée, car elle n’accède justement à un niveau théorique que si elle permet le surgissement du nouveau qui, en un sens, mais en un sens seulement, la détruira. Une sorte de principe de « falsifiabilité » à la Popper, mais dans le domaine politique. Et c’est ainsi à partir de Marx, mais contre ses thèses les plus explicites, que Castoriadis pense pouvoir faire apparaître qu’il n’y a pas de contradiction interne au capitalisme, ni de crise majeure en perspective – le vrai problème étant ailleurs. Le capitalisme n’a pas produit la société que Marx prévoyait, mais une société qui installe ses paradoxes à tous les niveaux par une sorte de double lien : elle intègre les individus du même geste par lequel elle les exclut. Elle exploite, mais demande l’adhésion des exploités sans laquelle elle s’effondrerait.
Le capitalisme offrira toujours des occasions révolutionnaires mais n’en nécessite aucune. Au contraire, il sait très bien résorber les forces contraires dans son propre système : faisant, par exemple, des syndicats un rouage de sa survie ; annexant le Parti communiste (PC) qui, si puissant fut-il, ne différait en rien des autres partis, si ce n’est qu’il réussissait mieux qu’eux à exploiter les salariés et la masse coloniale en organisant la bureaucratie et le totalitarisme. Le PC était un accélérateur de la société capitaliste, elle-même bureaucratique en son essence. Toute l’analyse de Castoriadis est fondée sur la capacité du capitalisme d’échapper à une crise majeure en nourrissant la paix sociale par l’augmentation des salaires, la diminution des heures de travail et l’abaissement de l’âge de la retraite. La crise financière n’était manifestement pas prévue (en revanche, Castoriadis prévoit Mai 1968 dès 1963, ce que peu, à part Alain Touraine, avaient fait).
Cependant, on peut penser avec Castoriadis que la question du sens s’affirmera de plus en plus et prendra une allure qui ne peut que nous parler, à nous, hommes du XXIe siècle : comment penser et agir dans un monde effondré ? De même, la société telle qu’il l’aurait voulue peut encore nous servir à déterminer le cap : une société est humaine lorsqu’en elle l’activité est intégrée, ouverte, intelligente. Au fond, c’est vraiment le communisme tel que Marx le voyait dans l’utopie promise à la fin de L’idéologie allemande, mais ici il ne s’agit pas d’utopie : bien au contraire, il s’agit d’être enfin réaliste et de reconnaître que nous sommes destinés à être maîtres et responsables de nos vies dans et par une activité collective que les hommes comprennent et dominent. Nous ne sommes pas si loin de Hannah Arendt. Or, au lieu de cette ouverture, les forces et les partis de gauche ne déploient que des mots d’ordre de production et de gestion, qui sont ceux-là mêmes du capitalisme.
En revanche, et heureusement, il y a une activité pensante autonome des masses. Elle appartient au refoulé de l’histoire parce qu’il n’y a pas de concepts aptes à la saisir, elle est agissante mais invisible, méconnue. Elle est praxis. Aussi bien il n’est nul besoin d’une théorie totale pour transformer la société. La praxis que Castoriadis conçoit peut opérer d’une manière souterraine et fragmentaire : « Nous appelons praxis ce fait dans lequel l’autre ou les autres sont visés comme être autonomes et considérés comme l’agent essentiel du développement de leur propre autonomie. » Rien de kantien ici, malgré la formulation proche de celle de l’impératif catégorique : l’autonomie des autres n’est pas une fin, « elle est, sans jeu de mots, un commencement ». « L’objet même de la praxis, c’est le nouveau. » Ce surgissement du nouveau par la confiance accordée à l’autonomie des autres est tout le contraire de la table rase chantée par l’Internationale : « Seule une société réellement vivante dans son présent pourrait restaurer pour elle-même la signification du passé. » Contrairement à la vue courte de certains révolutionnaires (ou contre-révolutionnaires) la disparition des classes sociales ne produirait pas celle de la culture classique, mais au contraire son déploiement. Car s’il faut réduire à néant l’opposition entre réflexion et action, c’est bien en Grèce que la praxis qui opère cette fusion est née et a pris conscience d’elle-même. Et il importe de l’étudier encore dans ses propres textes.
Aujourd’hui, une culture s’effondre sans qu’une autre ait été préparée à la remplacer. Mais qui pourrait prévoir ce qui surgira ? La praxis politique ne pourra qu’être absolument originale, imprévisible. Il faut sortir de la spéculation : l’action véritable n’est jamais l’application d’une pensée constituée ailleurs. Marx, malgré sa volonté de ne plus interpréter le monde mais de le transformer, n’en était pas sorti, « ainsi était une fois de plus occulté que l’être est essentiellement un à-être. » La véritable pensée signe l’alliance de l’imagination et de la rationalité. Elle ne se produit qu’à des moments de lucidité éphémère dans les sociétés ; et si toutes en sont capables, toutes, également, ne savent pas les pérenniser au-delà des situations qui les ont produits. C’est cette lucidité qu’il faut parvenir à fixer, à penser, à prolonger. En ce domaine, on ne peut compter que sur l’imaginaire social d’une société instituante remettant constamment en chantier la société instituée à partir des figures anthropologiques qu’elle engendre. Dès lors, il ne s’agit ni « de fonder, encore moins d’endoctriner, mais d’élucider. » Cette élucidation rejoint l’intuition centrale d’Aristote : « La Cité se met à exister pour rendre possible la vie des hommes. » Si, en effet, elle précède les individus, ils sont pourtant sa fin. Pour que l’opération ait lieu, la société doit entretenir avec l’imaginaire social un autre rapport, comme chacun peut entretenir un autre rapport à son inconscient, sans le supprimer ni le rendre transparent, mais inventif.
Tout cela, bien sûr, est assez exaltant – avec une réserve, du moins me semble-t-il. La faille chez Castoriadis me paraît sa haine de toute transcendance. Sa vision de l’histoire en devient schématique : la vérité politique est grecque, et la Grèce, c’est l’absence de transcendance (Ah bon ! C’est une nouvelle assez considérable…). La vérité survivra-t-elle à la période que nous traversons ? Pas sûr, elle est fragile. « Nous savons qu’elle n’a pas survécu à la montée de la barbarie chrétienne et qu’il a fallu un millénaire pour qu’elle ressurgisse. » Les propositions politiques de Cornelius Castoriadis peuvent, ainsi, devenir très ambiguës : je ne suis pas certain que l’autogestion soi, dans les entreprises, la solution à tous les problèmes. Proposer que les lois ne soient « que » le résultat d’une décision des citoyens met Castoriadis dans une dangereuse proximité avec le « entre nous tout est contractuel » d’un néolibéralisme qu’il ne pourrait pourtant qu’exécrer ; ou, à l’inverse, avec un gauchisme ou un populisme qu’il ne refuse pas moins, quand il envisage que la justice ne soit plus confiée à des professionnels mais à des jurys populaires désignés par le sort.
- Cornelius Castoriadis, Quelle démocratie ?, tome 1, Écrits politiques, 1945-1997, III, Éditions du Sandre, 2013, 694 p., 32 €
- Cornelius Castoriadis, Quelle démocratie ?, tome 2, Écrits politiques, 1945-1997, IV, Éditions du Sandre, 2013, 660 p., 32 €
20 février 2015