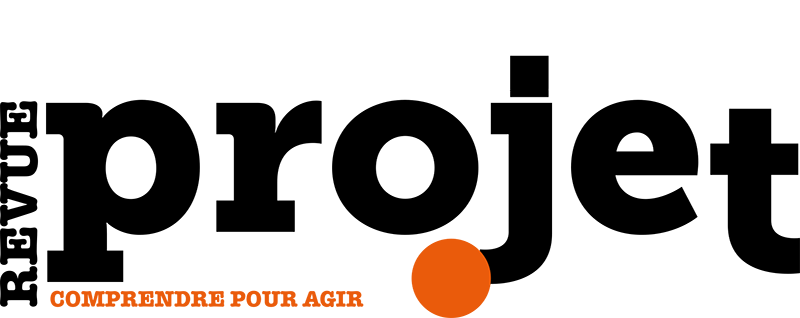Pour une théorie critique de la technique
Andrew Feenberg Lux/Humanités, 2014 [2010, trad. de l’anglais par Iketnuk Arnaq et Véronique Dassas], 465 p., 22 €Les lecteurs qui ont apprécié les intuitions de Repenser la technique (La Découverte/Mauss, 2004) attendaient de voir se déployer la théorie critique sous-jacente. Son éditeur l’avait demandée à Andrew Feenberg pour la publier en 2010. La traduction est désormais disponible en français. Des neuf chapitres de l’ouvrage, regroupés en trois parties, nous cherchons à présenter la progression pour évaluer si Andrew Feenberg réussit ou non à passer d’une théorie critique de la technique à une critique de la rationalité moderne.
La première partie dénonce la contre-utopie qui a paralysé la philosophie pendant les siècles de la révolution industrielle. Pour plusieurs générations, la nécessité technique semblait dicter la voie du développement et la recherche de l’efficacité permettait d’identifier cette voie. Mais depuis plus de trente ans, de nombreuses études du mouvement « Science, technique et société » ont démonté ce déterminisme technique et relativisé la construction sociale de l’efficacité. Que l’on songe, par exemple, à la façon technocratique dont on a fait le choix du nucléaire en France. Feenberg souligne la portée de ces travaux, qui appellent à faire entrer vraiment la technique en démocratie.
Le troisième chapitre oppose le schéma optimiste de C’était demain (1888) d’Edward Bellamy au récit pessimiste du Meilleur des mondes (1932) d’Aldous Huxley. Il souligne comment l’opposition entre technophiles et technophobes a structuré le débat philosophique d’Heidegger à Habermas, en passant par Marcuse et Dewey. Même l’impact d’internet est encore interprété d’une manière manichéenne. Pourtant, les nouvelles formes de participation en ligne attestent du potentiel démocratique de la technique numérique.
La deuxième partie explore ce que la philosophie de la technique peut emprunter à la sociologie. Dans la conception technique, les objets sont d’abord décontextualisés afin d’identifier des possibilités d’application (par exemple, les effets d’un médicament, les performances d’un opérateur). Puis ces objets sont intégrés dans des systèmes sociotechniques, selon des codes spécifiques (dont le plus simple est le mode d’emploi). Mais ces règles de conception reflètent une distribution inégale du pouvoir. Les groupes concernés peuvent alors contester les codes et influencer l’innovation. Dans le cas du Minitel, par exemple, le réseau de terminaux répartis verticalement pour distribuer l’information de haut en bas a été réorienté par ses utilisateurs en un système horizontal de communication. Cette contestation précoce d’un système préfigure la capacité d’agir des utilisateurs d’internet.
Cette double exploration permet d’interroger les liens entre rationalité et modernité dans une troisième partie. Feenberg regrette que les théories de la modernité, qu’elles insistent sur l’individualisme contemporain, les procédures du débat démocratique ou la sécularisation, continuent d’ignorer la technique. Il critique par exemple Habermas pour son dualisme méthodologique qui envisage de façon cloisonnée « le monde vécu » et l’abstraction des marchés et des administrations. À l’inverse, il reproche à Bruno Latour de monter en généralité à partir d’études de cas particuliers et, du coup, de se résigner à une solution procédurale dans Politique de la nature (2004).
Dans cette synthèse, Feenberg tente de généraliser sa théorie de la technique à la rationalité moderne. Il relève qu’en se prétendant universelle, cette dernière, comme la technique, oublie ses propres biais de conception et réduit ainsi ses possibilités d’application. Mais les tensions entre la conception de cette rationalité et le monde vécu donnent lieu à des revendications qui finiront par être traduites en de nouvelles conceptions, tout comme les inadaptations techniques conduisent à de nouvelles innovations.
Le dernier chapitre peut revenir alors sur le lien entre raison et expérience au moment où la raison technique déploie un énorme pouvoir destructeur (armes nucléaires, finance de marché) et où les significations de l’expérience deviennent outils de marketing (publicité, téléréalité...). Convoquant Heidegger, Feenberg fait remarquer que nous ne disposons pas « des perspectives que nous habitons et qui contribuent à faire de nous ce que nous sommes et qui nous sommes » (p. 425). Pour lui, la raison moderne doit s’ouvrir à d’autres sources de sens. Et il conclut ainsi son parcours : « Comme la technique, la sagesse se trouve elle aussi entre raison et expérience et ces deux modes de pensée ont besoin l’une de l’autre » (p. 426).
On l’aura compris, l’entreprise intellectuelle est ambitieuse et Feenberg ne prétend pas l’avoir terminée. Elle montre sa fécondité pour comprendre la teneur du débat public. En méprisant la technique, les pères fondateurs du système représentatif l’ont fait sortir de l’arène démocratique. Feenberg invite à en ouvrir les boîtes noires pour y introduire le débat. Et ce dernier prend tout son sens face à la crise écologique : « Nous pouvons dépasser les obstacles idéologiques pour créer un avenir meilleur en intégrant les valeurs écologiques dans les dispositifs techniques et économiques de notre société » (p. 111).
Malheureusement, le livre se limite à en poser le principe ! Certes, Feenberg souligne bien comment le dénigrement du mouvement écologiste redouble le manichéisme moderne en affirmant que valeurs et environnement seraient deux paradigmes irréconciliables. Il dénonce en particulier la théorie économique néo-classique qui enferme la critique écologique dans des compromis impossibles (biodiversité ou emploi, lutte ou adaptation au changement climatique). « Il ne s’agit pas de savoir si nous pouvons nous permettre ceci ou cela, il s’agit de se demander dans quel monde nous voulons vivre » (p. 91).
Mais Feenberg ne voit pas que, plus fondamentalement, la crise écologique nous oblige à repenser notre « être au monde ». Il affirme que les techniques pré-modernes étaient canalisées par « la religion » et « les coutumes locales » (p. 19). Peut-il en déduire de manière implicite que les techniques modernes en seraient dégagées ? S’il montre bien comment la modernité lie raison pure et raison pratique, il ne peut se passer d’une critique de la faculté de juger. Sans elle, Feenberg ne pourra poser les fondements d’une démocratie écologique qui suppose un sentir commun ou de grands récits. On s’étonne de ne pas retrouver dans l’index des auteurs comme Jonas (Le principe responsabilité, 1979) ou Bourg (Vers une démocratie écologique, 2010). Peut-on ignorer comment nos démocraties ont fait de la croissance leur assise matérielle ? Ignorer les débats sur le possible décrochage entre la croissance et l’énergie ? Pour mettre ici en œuvre sa méthode, Feenberg manque peut-être d’enquêtes économiques sur la transition écologique. Comme si la technique et l’écologie intéressaient plus les sociologues – et les philosophes – que les économistes !
12 novembre 2014