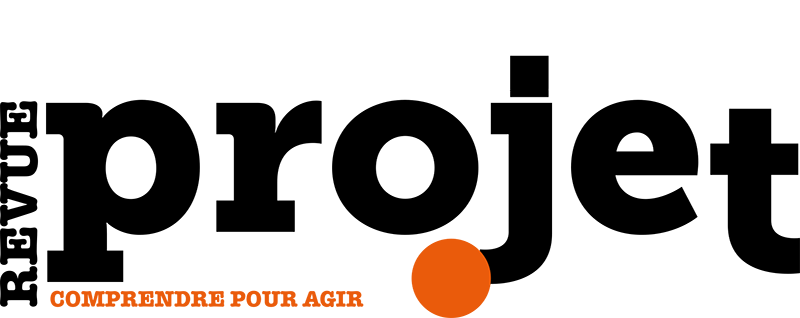Le titre dit Dieu et l’Europe, le sujet est plutôt le christianisme et l’Europe. Le christianisme « a fait l’Europe », qui en doute ? « L’Europe a défait Dieu », ensuite, dit Boissonnat. La vérité est que le christianisme a peu à peu reculé dans ce continent, en de nombreuses étapes, très diversement d’ailleurs selon les pays. Le plus certain est que « la chrétienté », ce composé de religion et de politique, s’est dissoute dès la fin du Moyen Age, avec l’arrivée des nations. On n’en était certes pas à ce que furent ensuite la corrosion par les nouvelles Lumières et, plus encore, les « religions séculières » du XXe siècle.
Le paradoxe qu’énonce Boissonnat, c’est que le christianisme peut aujourd’hui se trouver une nouvelle mission et avoir devant lui une « deuxième chance », mieux en harmonie avec sa vraie nature que son identification, pendant un temps, à un continent particulier, l’européen. Il peut contribuer de façon exemplaire à donner un sens à la vie mondialisée, s’ouvrant à bien plus que l’Europe (« Dieu n’est pas européen », dit Boissonnat). Ceci en profond rapport avec l’universalité, dès les origines, du christianisme, mais trop oubliée ensuite (malgré les élans missionnaires successifs, souvent certes paternalistes, puis colonialistes).
La mission qui se propose sera de caractère social et spirituel à la fois. « L’Eglise, depuis le XIXe siècle, a peut-être trop mis l’accent sur le moral et pas assez sur le social et sur le spirituel. Elle n’a pas suffisamment montré la responsabilité personnelle du chrétien dans l’action sociale, où il ne doit pas attendre de mots d’ordre de la hiérarchie, mais où il ne peut se dégager de sa responsabilité de chrétien. Quant à la vie spirituelle, elle trouve certainement une occasion nouvelle dans les préoccupations psychologiques des contemporains […] ».
Jean Boissonnat suppose assurément un réenracinement dans l’essentiel au lieu de ce qui reste(rait) encore de « chrétienté » : « Le christianisme européen, dit-il, doit retrouver le sens de la communion autour de la seule chose qui la fonde, à savoir la personne du Christ ».
Il note d’ailleurs que ce qui donne espoir aujourd’hui, c’est un enseignement social plus évidemment « tiré de l’Evangile ». C’est en effet le sens de la relecture conciliaire de cet enseignement dans Gaudium et spes (1965), comme plus d’un texte de Jean Paul II.
« Nul ne peut monopoliser Dieu s’il veut que Dieu soit accessible à tous les hommes ». L’Europe ne peut se l’approprier, elle ne peut pas davantage « s’approprier le christianisme ». Il n’y a pas de Dieu ou de religion d’une nation particulière ou d’un continent donné. Mais « c’est la source qu’il faut rendre accessible à chacun et non plus le cadre institutionnel qu’il faut imposer à tous (on a trop fait d’injustices « au nom de la justice » et d’erreurs « au nom de la vérité » dans les « institutions de la chrétienté » !).
Ces propos apparaissent surtout à la fin de l’ouvrage, je les considère pour ma part comme le centre du message de Jean Boissonnat. Au passage il fait un plaidoyer pour un effort sérieux d’accueil à la Turquie en Europe – face à tant d’opinions arrêtées d’emblée. Le plus important de son livre est, plus loin que ce problème, l’appel à une renaissance du christianisme dans sa mission universelle, par delà tous les dieux des nations – y compris, bien sûr, celui que s’approprie actuellement le président Bush.
On dira que l’auteur pratique la fuite en avant. L’Europe s’est défaite du christianisme, eh bien le christianisme n’était pas fait pour être européen (seulement). Je dis, quant à moi, oui, j’applaudis même, mais demande qu’on comprenne bien ce que cela exige. Un formidable et nouveau retour aux sources, d’abord. On en a pratiqué un après la deuxième guerre mondiale, en Europe, avec la relecture des « Pères » de l’Eglise ancienne, dont la fraîcheur a permis de dépasser nombre de pétrifications de l’Eglise post-tridentine : le Concile Vatican II est tissé des fruits de cette relecture. Mais on n’a peut-être pas autant relu l’Evangile même dans son immédiate simplicité, on n’en a pas encore assez profité, et on n’a pas assez donné l’occasion d’en profiter à des hommes de cultures très diverses, d’Asie, d’Afrique...
J’en arrive ainsi à la seconde exigence, d’inculturation. Il y en a eu un peu après le Concile, cosmétique tout de même, c’est-à-dire par l’adoption de quelques symboles rituels. Les esprits des séminaristes et des catéchètes ont continué d’être formés au moyen d’un bagage très euro-occidental, hérité des siècles d’ailleurs.
On entend parfois dire qu’il était temps qu’après le Concile quelqu’un siffle la fin de la récréation, ou qu’il était temps de mettre fin aux expériences, un temps autorisées. Et cela a eu lieu au fond. Je ne veux pas, à l’encontre, prêcher le désordre, mais je pense qu’en ce moment de début du XXIe siècle et de rapide mondialisation, il est nécessaire de nous dire que de nouvelles initiatives d’inculturation – dans la pensée avant le rite – sont indispensables si l’on veut dépasser un christianisme « cantonal » européen, comme nous y invite en somme Jean Boissonnat. Remarquons que c’est un économiste, très au fait de la globalo-mondialisation, qui nous parle, son appel est issu d’une vive perception du monde qui est et qui vient, il vaut d’être écouté.
1er juin 2005