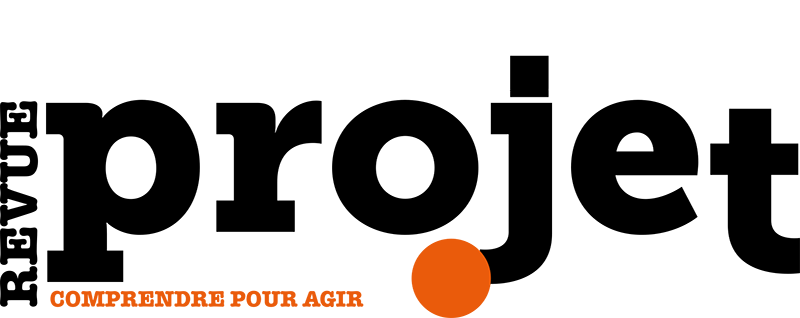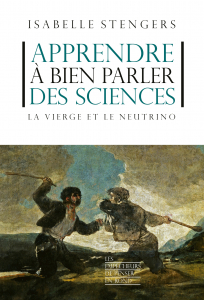Apprendre à bien parler des sciences La Vierge et le neutrino
Isabelle Stengers La Découverte, Les Empêcheurs de penser en rond, 2023, 272 p., 20,50 €.À contre-courant des tendances actuelles, la philosophe Isabelle Stengers propose une nouvelle manière de comprendre les sciences. Sa lecture permet de leur penser une place plus juste dans la société.
La réédition de l’ouvrage de la philosophe des sciences Isabelle Stengers, d’abord sous-titré Les scientifiques dans la tourmente (2006), s’accompagne désormais d’un titre qui souligne toute son actualité : Apprendre à bien parler des sciences (2023). L’ouvrage est édité aux Empêcheurs de penser en rond, une maison d’édition dont Stengers est, avec Philippe Pignarre, la fondatrice. Ce dernier écrivait récemment à propos de Stengers qu’elle « ne s’attarde jamais, tout en multipliant les propositions […]. Mais ne croyons pas que Stengers écrit sans hésitation. »
La Vierge et le neutrino semble corroborer ces dires, car l’hésitation est probablement l’attitude à laquelle Stengers accorde la plus grande importance. Le projet de Stengers vise à donner une place aux sciences, tout en leur refusant une autorité supérieure dans la définition de la réalité. Pour y arriver sans tomber dans le relativisme, Stengers s’appuie sur l’idée de « pratique » qu’elle caractérise selon deux aspects : exigence et obligation. À partir de ces deux aspects, elle entend démontrer que l’activité scientifique est « une “pratique”, certes, mais une pratique pas comme les autres, au sens où aucune pratique n’est “comme les autres” ».
Selon Stengers, chaque pratique se distingue dans la manière dont le praticien est engagé vis-à-vis d’obligations spécifiques qui le maintiennent dans un état d’hésitation orienté vers l’actualisation d’un type spécifique de réussite. Les physiciens, par exemple, peuvent s’accorder sur un discours concernant la « réalité » lorsqu’un dispositif expérimental parvient à mettre fin à leurs hésitations.
Stengers propose une voie de sortie de crise à une époque où se profile la disparition des obligations scientifiques au profit d’une « économie de la connaissance ».
Cette réalité ne dépend pas que des humains, mais elle n’en est pas pour autant indépendante. Elle est le résultat d’une mise en rapport particulière produite par le dispositif expérimental, et que Stengers décrit comme la réussite d’un rendez-vous donné à la « nature », avec ce que cela implique : « Jamais la réussite d’un rendez-vous ne permet de connaître ce qui y vient “tel qu’il est”, mais seulement de confirmer l’hypothèse en termes de laquelle le rendez-vous a été organisé. » Autrement dit, il n’y a aucune raison pour dire que cette « réalité » devrait intéresser tout le monde.
L’obligation est donc ce qui fait hésiter les praticiens. L’exigence, quant à elle, est ce qui les mobilise et les amène à affirmer une identité. Elle engage une question proprement écologique : « Toute pratique a besoin d’un environnement qui accepte de la nourrir sans l’asservir. La manière dont une pratique traduit ce besoin en termes d’exigence, et dont elle construit son identité propre dans des termes qui doivent inciter son environnement à satisfaire ces exigences, implique la question de cet environnement lui-même, c’est-à-dire de ce qu’il est prêt à accepter. »
Cette question écologique engage Stengers à proposer une voie de sortie de crise à une époque où se profile, d’une part, la possible disparition des obligations scientifiques au profit d’une « économie de la connaissance » et, d’autre part, une méfiance grandissante des publics vis-à-vis de la science. « Faire le pari d’une autre histoire possible », selon Stengers, revient à alors « penser la possibilité de lier autrement les scientifiques à leur milieu ».
Penser par le milieu
Au cours de l’histoire des sciences, le besoin de développer un environnement accommodant a amené les scientifiques à formuler une exigence d’autonomie. Pour Stengers, cette exigence est construite sur un mensonge, car les scientifiques n’ont jamais été autonomes. Ce sont des entrepreneurs spéculatifs qui effectuent un travail de connexion entre différents protagonistes, chacun assurant une part des différents besoins nécessaires à l’activité scientifique (alliés, ressources, reconnaissance professionnelle, légitimité publique).
Mais ce travail de connexion est fragile, car sa réussite est toujours conditionnée par la réussite expérimentale. Dès lors, plutôt que d’autonomie, il convient de reconnaître que la pratique scientifique requiert un territoire dont les frontières sont construites et négociées. C’est donc l’identification actuelle de ces frontières que Stengers nous invite à repenser.
Cela commence par dissoudre l’amalgame sur lequel ces frontières se fondent : l’idée selon laquelle « la science » serait la « tête pensante de l’humanité ». Défaire cet amalgame est alors une manière pour Stengers de montrer, d’une part, qu’il est possible de réunir les sciences tout en les faisant diverger et, d’autre part, que certaines pratiques assimilées à la science ne peuvent être considérées comme faisant partie des sciences (ce qui ne signifie pas qu’elles n’ont pas de légitimité à exister). Pour ce faire, Stengers retrace l’histoire de cet amalgame, puis propose de réunir les sciences à partir d’une question générique : comment peut-on apprendre du nouveau ?
Penser à partir des pratiques permet de libérer les sciences du comportement de leur soumission à la méthode de la science.
Cette question permet à Stengers de réunir sous la catégorie des sciences un ensemble de pratiques caractérisées par des obligations divergentes. Par exemple, ce qui fait hésiter les physiciens n’a pas grand-chose à voir avec ce qui fait hésiter les scientifiques qui travaillent avec des indices (comme l’égyptologue), ou ceux qu’elle réunit au sein des « sciences du comportement ». Ces dernières posent d’ailleurs un problème à Stengers, car elles sont sclérosées par une référence normative à la science qui les empêche de penser, les enfermant dans une quête d’identification à la pratique des physiciens.
Par ailleurs, la redéfinition du territoire scientifique amène Stengers à caractériser comme étrangères d’autres pratiques qui tirent profit de l’identité scientifique, comme les essais cliniques en médecine contemporaine, dont l’usage des statistiques n’a pas vocation à apprendre du nouveau, mais à faire le tri entre les « bonnes » et les « mauvaises » guérisons. L’essai clinique est, pour Stengers, un exemple de la manière dont « une tête qui ne pense pas, mais juge est susceptible de survivre, alors que serait détruit le territoire où les scientifiques se pensaient protégés contre l’asservissement. » Ainsi, penser à partir des pratiques permet à Stengers de libérer les sciences du comportement de leur soumission à la méthode de la science et d’empêcher certaines pratiques de se poser en juges détenteurs d’un mode de connaissance supérieur.
Pratiquer l’écologie
À partir de cette notion de pratique, Stengers défend la possibilité d’une écologie qui met l’accent sur le lien entre une réussite et le milieu où elle a été produite, une réussite qui incite les scientifiques à envisager d’autres relations avec leurs milieux, « à envisager qu’ils puissent être “obligés” par la question de “comment ce qui y est produit quitte leur laboratoire” ». Mais l’approche écologique de Stengers impose aussi ses propres exigences : « Elle demande une mise sur le même plan de l’ensemble [hétérogène] des protagonistes intéressés ou menacés par une innovation d’origine scientifique. »
C’est ici qu’apparaît la proposition d’une « écologie des pratiques » invitant à reformuler les exigences scientifiques afin de reconnaître aux publics une capacité d’objecter et de produire un savoir. Au-delà de la reformulation des exigences scientifiques, l’écologie des pratiques est également une manière différente d’appréhender le monde en reconnaissant ce que Stengers nomme la « vérité du relatif », par opposition au « relativisme de la vérité ». Pour Stengers, cela permet d’accorder une place non subalterne aux pratiques non scientifiques et aux différents modes de réalités qu’elles font importer.
L’écologie des pratiques est politique, au sens où le risque d’affrontement, de guerre et d’éradication n’est pas appelé à disparaître.
Il s’agit également d’une manière d’échapper à la bêtise moderne qui consiste à soumettre toutes les pratiques aux exigences scientifiques, négligeant par-là les obligations qui caractérisent chacune d’entre elles. La notion de pratique rend possible le rapprochement, dans leurs divergences, du scientifique et du pèlerin : « Ce qui importe pour eux, ce qui les fait exister comme physiciens et pèlerins, n’est ni l’accord entre humains ni le soulagement d’une souffrance au sens général. Ce qui importe est un événement dont il leur appartient de cultiver la possibilité. »
Chaque pratique se voit donc redéfinie comme une capacité à aboutir à une « production d’existence », à une manière de « faire lien » avec « quelque chose qui n’est pas nous, quelque chose avec qui un rapport pourrait être créé, mais qui nous obligera d’abord à l’apprentissage que requiert cette mise en rapport. » Vivre dans un monde qui prendrait en compte l’hétérogénéité des pratiques exigerait alors d’apprendre à se présenter, en tant que praticien, à partir des divergences que produit sa pratique.
Attention toutefois à ne pas considérer l’écologie des pratiques comme « la “bonne solution”, capable, enfin, de rassembler ». L’écologie des pratiques est fondamentalement politique, au sens où le risque d’affrontement, de guerre et d’éradication n’est pas appelé à disparaître. C’est sans doute pour cela que Stengers nous invite à accueillir sa proposition comme une « fable », certes capable de nous rendre présent au monde sur un mode nouveau, mais exempte de toute garantie. Bref, Stengers nous invite à continuer à hésiter.
19 janvier 2024