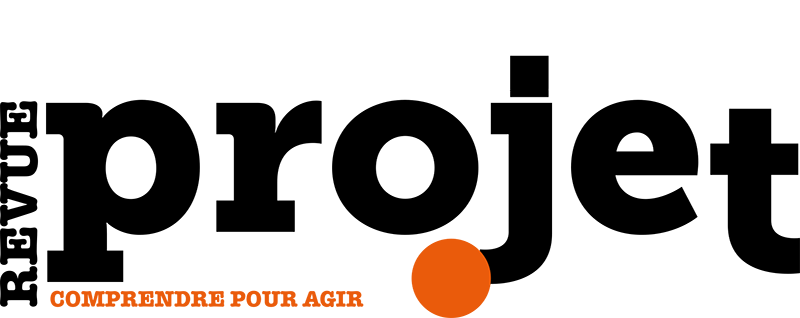Composer un monde en commun Une théologie politique de l’anthropocène
Gaël Giraud Le Seuil, 2022, 816 p., 27 €.De l’absoluité de la propriété privée à la question de la souveraineté démocratique, Gaël Giraud déroule sa fine connaissance de l’exégèse biblique pour penser les communs.
Le livre de Gaël Giraud, auteur bien connu des lecteurs de la Revue Projet, Composer un monde en commun. Une théologie politique de l'Anthropocène, n'est pas d'accès aisé. Les 750 pages sont denses, extrêmement érudites, parsemées de locutions latines et de citations en allemand.
Il s’agit de théologie politique, c’est-à-dire, très sommairement, de l’étude des relations entre le religieux et le politique, à partir du point de vue du religieux. L’ouvrage aborde le droit, l'économique, le politique, la sociologie, les cosmogonies... et la musique baroque. Cette note de lecture sera forcément subjective, n’étant expert en aucun de ces domaines.
Mais je suis entré dans l'ouvrage avec un a priori favorable, connaissant la puissance de réflexion et de créativité de l'auteur. Bien m'en a pris, car, malgré quelques errances en chemin, j'en ressors inspiré et stimulé en ces temps de questionnements face au désastre climatique.
Variations Goldberg
L'auteur revendique une filiation forte avec le théologien jésuite Christoph Theobald, de culture franco-germanique comme lui. Dès l'ouverture, il fait référence à son ouvrage Le Christianisme comme style, paru en 2007. À la manière d'un musicien ou d'un artiste, l'auteur entremêle fond et forme pour créer une œuvre ayant un style propre, personnalisé.
Le style de ce livre est bien plus qu'une manière d'écrire ou de réfléchir. Il en est le fil rouge, le phrasé musical sous-tendant l'œuvre. Les chapitres surprennent car ils développent presqu'à l'infini telle ou telle thématique, emmenant souvent le lecteur « hors piste ». On pourrait parler d'une pensée fractale, mais il s'agit plutôt de variations à la Goldberg. Giraud partage avec Theobald la même passion pour la musique de Jean-Sébastien Bach.
La Bible évoque la domination de l'homme sur la terre et sa responsabilité par rapport à la sauvegarde du vivant.
Le livre doit donc, de l'avis même de l'auteur, se recevoir comme une expérience musicale ou spirituelle, et moins comme l'argumentation linéaire et cartésienne d'une thèse. D'où ce sentiment d'être face à une œuvre baroque, scandée par des brisures de rythmes et de thèmes, mais reprenant régulièrement, en sourdine, la mélodie de base : l'appel à composer (musicalement) un monde en commun.
Propriété privée et dette
L'idéologie post-libérale est fondée en grande partie sur le caractère absolu de la propriété privée. L'auteur consacre le chapitre 6 de son livre à ce qui pourrait théologiquement fonder notre rapport aux choses, au réel. La Bible évoque tout à la fois la domination de l'homme sur la terre et les espèces vivantes (Gn 1, 28) et la responsabilité de l'homme par rapport à la sauvegarde du vivant (Gn 2, 15).
Jusqu'au XVIe siècle, l'interprétation chrétienne est que Dieu est le seul maître (dominus) de la création. De Basile de Césarée à Thomas d'Aquin, en passant par Ambroise de Milan, Augustin et les Décrets de Gratien, les réalités sont par nature communes, à destination universelle.
La gestion en commun des biens entraînant des litiges et des conflits, la propriété privée devient un mal nécessaire. Elle est, pour Saint Augustin, « une conséquence inévitable du péché, tandis que, sous la plume de Gratien, elle en devient la cause » . La destination universelle des biens, principe de la doctrine sociale actuelle de l'Eglise, se situe dans la droite ligne de ces penseurs.
Dans la logique libérale, la propriété privée est le meilleur rempart contre le despotisme étatique et l’inefficacité supposée des communs.
Comment se fait-il qu'on soit passé d'une telle vision à celle, absolutisée, de la propriété privée ? Giraud place le retournement de perspective chez Locke, qui fait de la propriété privée, non plus un élément du droit positif (ius gentium) mais du droit naturel : l'humanité s'est vue dotée par Dieu d'un droit inaliénable de s'approprier les choses.
D'après Locke (1690), Dieu a donné la terre « pour l'usage de ceux qui seraient industrieux et rationnels (et le travail devait être un titre à sa possession), et non pour satisfaire le caprice et l'avidité de ceux qui seraient querelleurs et chicaniers ». La terre appartient donc à ceux qui travaillent.
On entre ici dans l'ère du libéralisme économique, pour lequel la propriété privée est le meilleur rempart contre le despotisme de l'Etat ou l'inefficacité des communs. Inefficacité pour qui ?
Giraud rappelle que le système des enclosures, à la fin du Moyen-Âge en Angleterre, a mis fin à l'utilisation commune des forêts (glanage, marronnage, affouage), en particulier pour les plus pauvres. Un prolétariat urbain apparut, main d'œuvre providentielle à l'industrialisation naissante.
Une tronçonneuse ou une énième voiture n’apportent que la jouissance d'en être l'unique propriétaire.
L'auteur, à la suite de David Graeber, montre l'aporie d'un droit absolu à la propriété privée. Ce droit est toujours encadré par des lois, et se réduit souvent 'à la jouissance d'être le seul à pouvoir en jouir. C'est un droit « against all the world ».
En effet, que peut-on faire avec une tronçonneuse ou une énième voiture ? Pas grand-chose, si ce n'est de jouir d'en être l'unique propriétaire. L'absoluité du droit de propriété n'est compréhensible, suivant Graeber et Patterson, que parce qu'elle visait à l'origine les esclaves et non les choses.
Finalement, dans ce parcours pour déconstruire le concept de propriété privée, Giraud s'attaque à la relation de l'homme à Dieu : sommes-nous la propriété privée de Dieu, endettés depuis l'origine de par le don de notre existence ?
« La thèse que je voudrais défendre ici est la suivante : ce dont l'événement christique nous “sauve”, c'est de cette mythologie perverse. Plus précisément : la relation privée à Dieu que présuppose le mythe de la dette primordiale est la source du péché ; elle constitue l'une des manières - sinon le mode privilégié -, pour nos sociétés, de dire “non” à l'offre gracieuse d'auto-commun-ication de soi de Dieu. [...] Dire que Dieu se communique comme commun, c'est affirmer à la fois l'universalité de l'offre de grâce divine et sa vulnérabilité à toute tentative d'appropriation privative ».
Domaine public, droit et souveraineté
Une théologie politique ne peut faire l'impasse sur les questions de souveraineté et de droit. S'appuyant sur les écrits d'Alain Supiot et de Jacques Derrida, l'auteur souligne que toute autorité, ainsi que toute loi, renvoie à une source externe.
Contrairement aux thèses autocratiques de Carl Schmidt, qui « définit le “souverain“ comme “celui qui décide de l'état d'exception”, compris comme “suspension de l'ordre juridique tout entier” », Giraud prône, à la suite de Supiot et de ses réflexions sur la personne comme entité s'autolimitant librement, une souveraineté définie « comme l'art de se donner des limites et de s'y tenir ».
L'argument au cœur de cette définition est la non coïncidence entre le droit et la justice. Le sentiment de justice (ou d'injustice) est commun, même si le droit qui en découle est particulier et souvent objet de délibérations ou de controverses. La règle d’or, se mettre à la place de l’autre, devrait constituer le principe de cette souveraineté s’autolimitant.
Finalement, tout comme pour la propriété privée, la justification théologique de la souveraineté et de la loi (publicum), à partir d'une conception « top-down » [glorieuse] de la Seigneurie divine, est elle aussi déconstruite.
Théologie de l’effacement
Que ce soit pour le privé (destination universelle des biens) ou pour le publicum (sentiment universel de la justice), un commun semble exister à l'origine. Comment fonder cette intuition théologiquement ? L'auteur consacre la majeure partie de ses réflexions à cette tâche. Il se focalise sur l'événement de l’Ascension, moment fondateur de la première communauté chrétienne.
À partir de recherches exégétiques et de méditations bibliques, il développe une vision de la Seigneurie [souveraineté] du Christ élevé de terre, comme « effacement ». Effacement qui, à la manière de parents qui se retirent pour que grandisse leur enfant, laisse place à la liberté de chaque membre de la communauté.
Le commun n'est plus un bien (voire une dette) mais une unité dans la diversité.
Cet effacement permet une pluralité de styles. Cette diversité s'exprime dans le don de langues reçu à la Pentecôte. « Chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.' » (Ac 2,6) Le commun n'est plus un bien (voire une dette) mais une unité dans la diversité. Il s'agit d'un entre-nous, de l’ordre de la relation ou de la communication, comme devrait l’être la fraternité.
À partir de ce renversement [une gouvernance d’effacement et non de domination], une théologie politique de la démocratie, là où « le lieu du pouvoir est vide », peut s’ébaucher.
Mais rien n’est écrit d’avance, ou dicté d’en haut. Il s’agira d’inventer démocratiquement les communs. « Comment croire à un public […] soumis à une délibération qui dépasse largement les enceintes usuelles de nos parlements puisqu’elle se doit d’impliquer les vaincus et les pauvres, les générations futures et les non-humains qui peuplent Gaïa ? Comment oser composer un monde en commun avec de tels partenaires ? ». Grave (et bonne) question.
17 février 2023