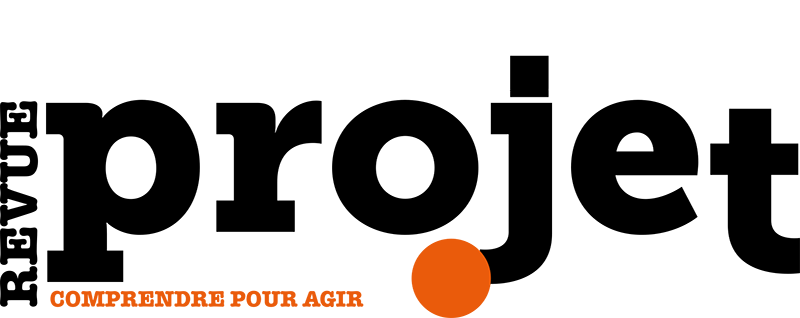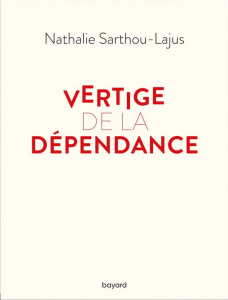Alors que l’autonomie est élevée en vertu cardinale, la philosophe Nathalie Sarthou-Lajus explore la dépendance. Loin de chercher à s’en libérer, elle y voit le signe d’une maturité relationnelle.
La dépendance fait partie intégrante de notre condition humaine. Dans la lignée de ses travaux sur la dette, Nathalie Sarthou-Lajus remet à l’honneur cette notion, séparant son possible effet toxique – relevant de l’addiction – d’un effet thérapeutique et de mise en relation. La dépendance est plus manifeste dans les périodes de vulnérabilité, de l’enfance à la vieillesse, dans la maladie, les situations de handicap, la grande pauvreté, etc., mais elle n’en caractérise pas moins ce que nous sommes à tout instant.
Pourtant, nous sommes enclins, en Occident, à voir ces situations de vulnérabilité comme des diminutions angoissantes par rapport à une autonomie adulte qui serait le propre de l’humanité. L’ouvrage propose de repenser la dépendance, d’en dégager la dimension heureuse sans en nier les formes destructives, nous permettant de la reconnaître comme constitutive de ce que nous sommes.
L’autrice procède en quatre temps. Après un point sur les pathologies de la dépendance, elle s’attache à montrer ce qui relève d’une « dépendance heureuse ». Elle revient alors sur la manière dont le discours philosophique prend en charge cette ambiguïté, avant de proposer une éthique de la dépendance.
L’addiction met dans une tension désespérante, voulant à la fois être et ne pas être soi.
Le constat est là : nos sociétés fabriquent de la dette et de l’addiction, remettant en cause l’autonomie (qu’elles proclament par ailleurs) et les relations de confiance et de soutien. Car dette et addiction sont liées : addictus, « être dit par », était le propre de l’esclave qui n’avait d’autre nom que celui donné par son maître. Et, au Moyen Âge, le terme désignait un débiteur incapable de payer sa redevance.
Aujourd’hui encore, l’addiction garde ce sens de ne plus être maître de soi, et il n’y a pas de liberté sans rupture de ce type de dépendance. Elle met en effet le sujet dans une tension désespérante, voulant à la fois être et ne pas être soi, selon le mot du philosophe danois Søren Kierkegaard. Mais ce lieu est aussi celui d’un vertige extrême où le danger de mort peut libérer une énergie vitale capable de rendre au monde. Nous sommes alors invités à être attentifs à la dimension thérapeutique d’un risque mesuré. Tels ces apéritifs du temps de pandémie pris au bénéfice du lien et du goût de vivre retrouvé.
Remède et poison
Freud l’avait montré : les drogues, tout comme l’amour et la foi, apaisent les souffrances dues à la vie en société. Mais si l’attachement à l’autre ou à Dieu peut être pathologique, il est aussi expérience de libération. La toxicomanie enferme, mais l’amour et la foi sont ouverture à l’autre, au lieu même où cette ouverture confine au vertige de la perte de soi : c’est là que la perte peut se changer en une expérience d’élargissement de soi, d’accroissement de vie, de soif renouvelée de justice et d’amour.
La philosophie a travaillé cette ambiguïté de la dépendance, sous la figure du pharmakon (à la fois « remède » et « poison »). Pour Jacques Derrida, le premier pharmakon est le discours : il peut tout autant asservir que libérer. Avec Michel Foucault, il s’applique dans l’examen de conscience ordonné au plaisir d’être soi, comme exercice de tempérance – cet art de rester maître des plaisirs qui menacent le « soi ».
La dépendance heureuse est signe d’une maturité relationnelle.
Se trace ainsi la frontière entre ivresse dansante et alcoolisme titubant. Il s’agit alors moins de combattre la dépendance comme telle que de chercher à réduire sa toxicité. Le philosophe explore la voie médiane entre l’avidité et l’abstinence, où l’insatisfaction heureuse – le rejet des plaisirs qui détruisent – est l’envers d’une dépendance heureuse, signe d’une maturité relationnelle.
Comment résister, dans la société de l’addiction qui est la nôtre, au cercle vicieux de l’isolement et de la consommation ? En commençant par soi-même. La Boétie avait raison : la servitude volontaire est ce qui d’abord nous tient. Les pensées de care offrent en cela leurs ressources, car elles recentrent l’attention sur les relations, en particulier aux autres vulnérables. Nathalie Sarthou-Lajus cite encore les Alcooliques anonymes, avec leur souci de restaurer et soutenir la volonté que l’addiction fragilise.
La visée d’une éthique de la dépendance ne sera pas tant la guérison, même si elle peut advenir – elle viendra alors par surprise – mais l’union des forces dans le combat, le passage de l’isolement à la relation : un surcroît de force est donné à la volonté combative, un excès, une ouverture, comme un remède au désespoir. Cet excès qui a pu être destructeur devient alors créateur. Cette proposition est précieuse à entendre au moment où, avec la pandémie, nous entrons dans une période critique de la vie sur notre planète.
21 juin 2021