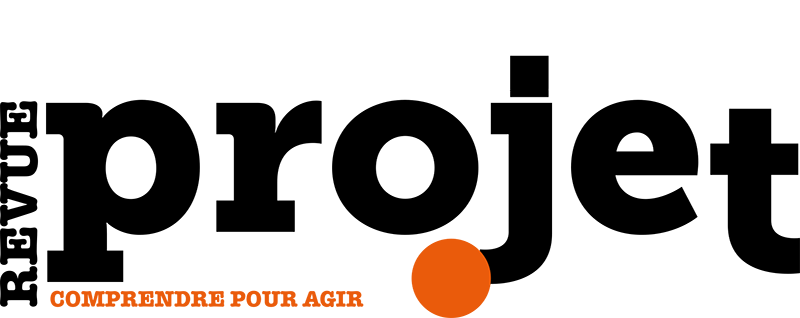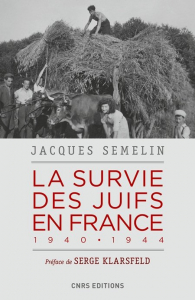Jacques Semelin travaille depuis des années sur la violence de masse : historien et politiste, « la question du génocide des juifs européens n’a cessé de [l]’habiter » (p. 15). Son ouvrage Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides (Seuil, 2005) est un incontournable des recherches sur les violences de masse. L’intérêt de sa nouvelle publication, forme abrégée et révisée de Persécutions et entraides dans la France occupée (Seuil - Les Arènes, 2013), est de porter le regard sur une évidence oubliée de notre histoire. Si 80 000 juifs en France sont morts lors du génocide, 240 000 d’entre eux (soit 75 %) ont survécu. À titre de comparaison, 5 % ont été tués au Danemark, 75 % aux Pays-Bas, 90 % en Pologne.
Semelin retrace les chemins de « l’histoire et des mémoires de la non-déportation des juifs de France » (p. 22) en s’appuyant sur maints témoignages, écrits ou recueillis oralement, parfois enrichis de photos. Avec toute sa rigueur d’historien – on imagine le travail d’archives mené par l’auteur, confirmé par la précision des références en fin d’ouvrage –, il discerne plusieurs éléments qui ont freiné la persécution. D’un côté, des juifs adoptaient des tactiques d’évitement, individuelles ou familiales. De l’autre, la population française témoignait de réactions hétérogènes, parfois par intérêt financier, mais surtout par solidarité de cœur. Ainsi « ces hommes, ces femmes, ces enfants n’ont pas été que dans la souffrance et la solitude » (p. 302). Semelin justifie souvent son approche, comme si parler de la survie de nombreux juifs en France, rendue possible grâce à une « solidarité des petits gestes » et à « mille et une manières d’aider et de protéger » (p. 273), pouvait être perçu comme une volonté de minimiser la tragédie du génocide. Pourtant, en rendant visible un angle mort des recherches sur la période de l’Occupation, l’auteur donne chair à ces familles qui ont survécu à la guerre et à la persécution. Il permet également de comprendre quelques caractéristiques de la société française.
Le panorama relatant les moyens adoptés par les juifs pour échapper à la mort est large : si des réseaux étaient actifs (résistance, organisations chrétiennes), il s’agissait aussi de choix, de moments, de lieux, de rencontres et, parfois, de hasard et de chance. La question de la survie, qui relève tant de la morale (sauver un homme) que de la pratique (comment faire), est abordée par l’auteur en quatre chapitres qui incarnent des moments types d’expérience de la guerre : la dispersion, la débrouille pour survivre face à la persécution, la dissimulation dans la population et, enfin, l’entraide spontanée envers les persécutés. On comprend tout de suite, et la conclusion le rappelle, que la survie des juifs en France est « multifactorielle ».
Se dresse d’abord l’histoire de la menace : quand cette dernière approche, mais qu’elle n’est pas vraiment prise au sérieux, puis quand elle est palpable et que les choix se restreignent. Alertée par les rafles et les récits de guerre, l’opinion publique prend progressivement conscience des atrocités commises envers une part de la population. Indignées, nombre de personnes tendent alors des mains secourables. Dans un contexte où il fallait combattre les Allemands, aider les juifs était aussi pour beaucoup un moyen de s’opposer à l’ennemi, notamment dans la zone dite « libre », où les marges d’action étaient plus grandes. Mais c’est surtout en partant « de la manière dont les persécutés eux-mêmes ont réagi à leur persécution » (p. 19) que les nombreux récits rapportés par Semelin donnent un aperçu réaliste de la vie sous l’Occupation. Par exemple, l’enjeu de la falsification des papiers officiels (dont ceux d’identité) est illustré par ce médecin qui, interdit d’exercer sa profession, se réfugie en zone libre, modifie son nom sur le document, et continue de travailler. Quand le danger est là et qu’il faut se dissimuler, la conversion au catholicisme ou le baptême des enfants furent parfois une solution (en général, on se contentait de délivrer de faux certificats de baptême). Mais beaucoup continuaient à pratiquer discrètement leur religion, prenant parfois conscience de leur judéité sous la persécution. Sous l’Occupation, il y eut aussi des histoires d’amour et, « autre manifestation de résistance de l’intime » (p. 200), des naissances. Ces diverses formes, tantôt de micro-résistances individuelles, tantôt plus organisées et collectives, expliquent partiellement le taux de survie des juifs.
Plusieurs autres facteurs contribuent à expliquer ce taux élevé. Outre la géographie du pays (l’accueil était moins risqué dans des zones rurales reculées et certains juifs durent apprendre à devenir paysans), l’antisémitisme ne fut pas uniformément virulent et a eu comme contrepoint nombre de « petits gestes » de la part d’« aidants » dont les interventions rencontraient, par ailleurs, une répression mesurée. Des organisations juives, chrétiennes ou laïques s’appliquaient à sauver les juifs avec des formes de résistance civile (en les cachant, les déplaçant vers un endroit plus sécurisé, et les aidant à se fondre dans la population). Le régime de Vichy qui, au début, allait au-devant des ordres de Berlin, devint peu à peu réfractaire à l’extermination des juifs, notamment parce qu’il était sensible aux réactions de l’opinion et se concentrait sur d’autres enjeux stratégiques. Il devait aussi se soumettre aux lois françaises : « La citoyenneté française a protégé de la déportation » (p. 299). Semelin rappelle comment la politique sociale de la France envers les réfugiés a pu, paradoxalement, bénéficier aux juifs : d’une main, le gouvernement collaborationniste décrétait des lois antisémites quand, de l’autre, il leur versait des allocations de subsistance. Cette présence de l’État fut un des facteurs ralentissant l’emprise d’extermination du projet de Berlin (en Pologne, où le gouvernement n’était plus, les juifs furent presque tous exterminés).
Par ailleurs, des réseaux de sociabilité informelle, tels que les liens de voisinage, ont permis à des personnes de devenir ponctuellement des « anges gardiens » : face au danger, aider la victime « est une simple réaction humaine » (p. 253). Combien de vies ont ainsi été sauvées par des concierges qui prévenaient les habitants de l’imminence du danger ! Les familles juives allaient alors se cacher avant de réintégrer leur logement et de continuer à y vivre, ou d’organiser leur départ dans un endroit plus sûr.
Arrêtons-nous sur les facteurs culturels et structurels relevés par l’auteur. Protestants et catholiques se sont souvent élevés contre la persécution des juifs. Le 23 août 1942, Mgr Saliège, archevêque de Toulouse, faisait lire dans toutes les églises de son diocèse un message déclarant : « Les juifs sont des hommes, les juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. » Cet appel à la charité chrétienne trouva un écho auprès de la population et contribua à refroidir l’ardeur des autorités vichystes dans leur chasse aux juifs. Le profond ancrage historique de la relation entre les juifs et la République, notamment avec l’acceptation des enfants étrangers juifs dans les écoles, fut aussi un soubassement idéologique fort pour freiner la persécution. Malgré tout, le degré d’intégration sociale des juifs fut déterminant, ce qu’illustre la forte différence des taux de survie entre les juifs français (sauvés à 90 %) et les juifs étrangers qui étaient arrivés comme réfugiés dans les années 1930 : parmi ces derniers, seulement 60 % échappèrent à la déportation.
Les dynamiques de la guerre, enfin, ne sont pas absentes de l’ouvrage, que ce soit au niveau des offensives guerrières (la chute du Reich encouragea l’entraide) ou économiques (Berlin eut une action plus modérée dans l’ouest de l’Europe pour en préserver le socle industriel).
Si le projet politique du Reich était d’envoyer des centaines de milliers de vies à la souffrance et à la mort, il ne réussit, en France, que pour 80 000 d’entre elles. Ce chiffre est évidemment terrible, mais il est réconfortant de comprendre comment la raison, la résistance, l’indifférence ou, tout simplement, l’humanité, ont permis d’en sauver 240 000. Semelin montre ici qu’il n’y avait pas d’uniformité dans la population française et qu’un projet mortifère ne prend pas facilement racine dans un pays qui possède un terreau historique et un tissu social aussi forts.
12 juillet 2019