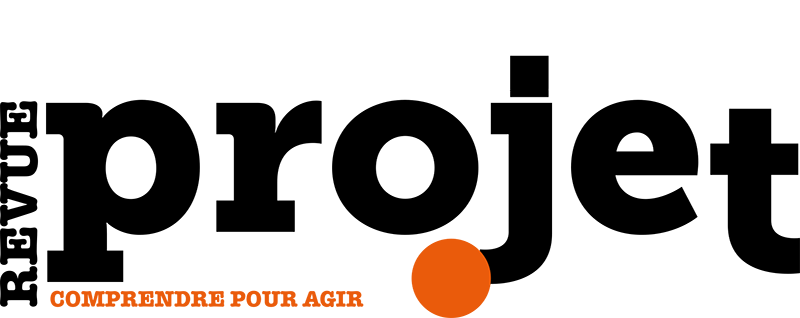L’écologisme des pauvres. Une étude des conflits environnementaux dans le monde
Joan Martínez Alier Les Petits matins/Institut Veblen, 2014 [2002, trad. de l’espagnol par André Verkaeren], 670 p., 25 €L’écologie, une préoccupation réservée aux nantis ? Bien au contraire, nous explique Joan Martínez Alier, dans son ouvrage L’écologisme des pauvres, un classique de l’écologie politique. Paru en 2002, réédité en 2008 au moment de la crise financière, il est désormais traduit en français. L’auteur bâtit sa démonstration à partir de l’idée d’une écologie populaire, prenant sa source dans les conflits relatifs à la répartition des « biens » (comme le pétrole) et des « maux » environnementaux (comme la pollution). Davantage issue des pays du Sud, elle est présentée comme le troisième courant de l’écologie, avec ses caractéristiques propres, distinctes du courant du « culte de la nature sauvage » et de « l’éco-efficacité », prévalant en Amérique du Nord et en Europe.
Des plantations d’hévéas du Brésil aux plateformes pétrolières du Nigeria, l’auteur observe les luttes liées à l’extraction des ressources du sous-sol, au stockage de déchets dangereux, à la destruction de mangroves, à la gestion de l’eau, à la pollution, à l’aménagement urbain, etc., des phénomènes contre lesquels se soulèvent ceux qui en souffrent le plus : des populations défavorisées. Ce « cœur empirique » de l’ouvrage, dense et bien documenté, révèle des mouvements qui, certes hétérogènes, revendiquent cependant une cause commune : celle de la justice environnementale, soit davantage de justice sociale entre hommes, y compris par rapport à l’environnement. Retraçant les liens entre luttes contre des inégalités sociales (voire le racisme) et destruction de l’environnement, Joan Martínez Alier se situe dès lors à rebours des théories post-matérialistes, portées par Ronald Inglehart, selon lesquelles les revendications « environnementales » ne peuvent être que l’apanage d’une classe aisée ayant comblé ses besoins matériels.
Ces différents récits donnent par ailleurs corps aux débats actuels sur les paradigmes de la justice sociale, bousculés par les enjeux environnementaux. Ils signalent à la fois la nécessité de penser la justice au niveau global – si nombre des conflits se déroulent en Amérique du Sud et en Afrique, ils sont liés à la surconsommation des pays du Nord – et de l’articuler avec l’environnement. On aurait cependant aimé en savoir davantage sur les limites du modèle proposé : l’élargissement de la justice distributive à l’environnement est-il suffisant pour conjuguer préservation et justice sociale ? L’auteur n’y fait qu’une allusion : cette « éthique naît d’une demande de justice sociale contemporaine entre les êtres humains. Je considère cet aspect à la fois comme un facteur positif et comme une faiblesse ». Ce choix peut néanmoins se comprendre, car le but de la démonstration n’est pas là.
Joan Martínez Alier, militant de la dette écologique, professeur d’économie et d’histoire de l’économie à l’Université de Barcelone, s’intéresse ici à la relation entre ces conflits sociaux liés à l’environnement et les divers langages de détermination de la valeur. Il parvient ainsi à articuler les champs théoriques de l’économie écologique, dont il est une figure, et de l’écologie politique. Le premier s’est constitué autour des frères Eugene et Howard Odum, de Herman Daly et de Robert Costanza à partir des travaux précurseurs de Nicholas Georgescu-Roegen, qui applique la loi de l’entropie à l’économie. Ils rejettent l’idée que l’activité économique puisse évoluer en cercle fermé, sans pertes (soit l’idée d’un recyclage total des matières premières), et intègrent les connaissances issues de l’écologie pour fonder leur analyse économique et établir des conditions de « soutenabilité ». L’écologie politique émerge quant à elle dans les années 1970 aux États-Unis, à partir de travaux en géographie qui s’attachent à l’étude des droits d’accès aux ressources et des conflits qui y sont liés. Si elle est aujourd’hui un champ beaucoup plus complexe, elle tente toujours d’articuler une analyse des dimensions conflictuelles des savoirs, des représentations et des facteurs biophysiques.
En étudiant les conflits « écologico-distributifs » passés et actuels, J. Martínez Alier décrit les différentes conceptions de l’environnement, les divers langages de valorisation qui s’affrontent, ceux qui dominent en particulier : l’idée d’environnement comme nature sauvage à sanctuariser et la valorisation monétaire via des calculs coûts/avantages. Or l’économiste met l’accent sur une « incommensurabilité » des valeurs : l’existence de différents systèmes de valeurs qui ne peuvent être exprimés dans les mêmes unités, le prix n’étant qu’un élément propre à la sphère marchande. La valeur que l’on donne à une forêt, par exemple, peut venir de l’attachement de ses habitants, de sa dimension esthétique, de la qualité de son écosystème ou de la valeur économique de son bois coupé. L’auteur détaille alors une méthode d’évaluation multicritères basée sur des indicateurs socioculturels et biophysiques1.
Ces liens tissés entre, d’une part, luttes locales et enjeux globaux et, d’autre part, enjeux de soutenabilité et incommensurabilité des valeurs font le grand intérêt de ce livre accessible. On pourra regretter que l’auteur n’explicite pas davantage le processus de formation des valeurs, qui apparaissent parfois comme des états de fait. Cette critique s’inspire directement de l’approche des sociologues pragmatiques, à l’image de Laura Centemeri, pour lesquels donner la place centrale à la valeur, plutôt qu’au processus de sa qualification, conduit à la considérer comme « une occurrence d’un monde mental ou subjectif séparé de l’expérience2 », une donnée sans émotions. Revenir sur ces processus permettrait pourtant de mieux comprendre la notion d’incommensurabilité – comment traduire dans une même matrice des valeurs issues du vécu personnel ? –, de saisir la façon dont un système d’évaluation devient dominant et légitime – comment le réductionnisme économique est-il devenu une forme d’exercice du pouvoir ? –, mais aussi d’approfondir la discussion sur « ce à quoi nous tenons »3. De tels détours rendraient davantage possible la définition des moyens et stratégies de cette « résistance » à laquelle J. Martínez Alier nous invite.
1 Par exemple, le taux de retour énergétique permet d’évaluer la quantité d’énergie consommée pour produire de l’énergie. Aux États-Unis, il fallait environ 1 baril de pétrole investi pour en produire 100 en 1930, en 2005, il fallait investir 1 baril pour en produire 12 (AIE, 2010).
2 Michel Renault, « Dire ce qui compte : une conception pragmatique de la formation des valeurs », actes du 1er colloque « Penser l’écologique politique », 13 et 14 janvier 2014, Institut Mines-Telecom, pp. 188-190 [en ligne].
3 Émilie Hache, Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragmatique, La Découverte, 2011.
5 mars 2015