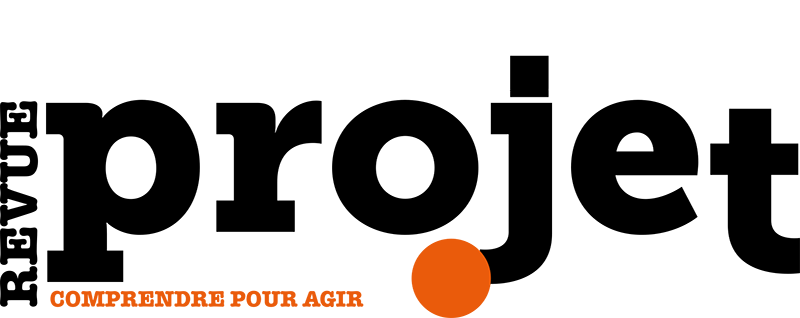La cause des « sans ». Sans-papiers, sans-logis, sans-emploi à l’épreuve des médias
Guillaume Garcia Pur, 2013, 286 p., 18 €Existe-t-il une recette pour intéresser les médias aux chômeurs, aux sans-abri et aux sans-papiers ? En refermant ce livre, l’on pourrait répondre positivement. Ou presque. Si l’auteur nous révèle ici les ingrédients à utiliser, c’est aussi affaire de timing et de dosage. Au départ de l’enquête, une question : pourquoi la presse, habituellement peu intéressée par l’immigration irrégulière, le chômage et le mal-logement, s’est-elle emparée de ces sujets au milieu des années 1990 ? Cette thèse, remaniée et abrégée, expose « ce qui se joue à l’interface du monde des médias et de celui des mouvements sociaux », afin de comprendre les conditions qui ont rendu possibles les rencontres entre journalistes et porte-paroles de ces groupes.
G. Garcia a étudié les sujets liés à ces causes diffusés dans les éditions de 20 heures des journaux télévisés des deux chaînes grand public (TF1 et France 2), entre 1990 et 2002. Sur cette période, trois mouvements de « sans » ont reçu une attention particulière : le premier fut celui des sans-logis de la rue du Dragon, à Paris. À partir de l’hiver 1994, des familles, majoritairement africaines, y occupent un immeuble vide sous l’impulsion du Dal (Droit au logement) et du CdSL (Comité des sans-logis). Le deuxième mouvement a été celui des sans-papiers campant dans l’église Saint-Bernard, à Paris, au printemps et à l’été 1996, suivi de la protestation contre la loi Debré sur l’immigration début 1997. Le troisième fut l’occupation de bureaux des Assedic par des chômeurs durant l’hiver 1997-1998. Pour compléter son enquête, Guillaume Garcia a mené plusieurs entretiens avec, en particulier, des représentants d’organisations de « sans » (Dal, Dd!!, CdSL, coordination nationale des sans-papiers, coordination des cinéastes, AC!, MNCP, APEIS, comités de chômeurs CGT) et des journalistes des chaînes concernées ; il a effectué un stage d’observation de deux semaines au sein de la rédaction nationale de France 2. Tous ces matériaux lui permettent de croiser intelligemment sociologie des mouvements sociaux, sociologie des médias et sociologie de l’action publique, des approches habituellement séparées. C’est là l’un des intérêts majeurs de l’ouvrage.
Une mobilisation réussie, nous dit Guillaume Garcia, nécessite le recours à des « modes d’action perturbateurs et visibles ». Ces actions doivent mettre au jour une injustice et interpeller les pouvoirs publics : accéder au statut de cause publique nécessite d’engager la responsabilité de l’État. Le moment doit être propice médiatiquement (l’occupation des Assedic s’est déroulée autour de Noël, une période où les téléspectateurs sont enclins à éprouver de la compassion) et politiquement (texte de loi en discussion, campagne électorale). Cependant ces quelques ingrédients ne sont pas, à eux seuls, une garantie de succès. L’auteur souligne régulièrement la complexité des phénomènes analysés et montre comment une infinité de paramètres entrent en jeu. Ainsi, l’incohérence ou les hésitations des politiques profitent à l’installation des collectifs de « sans » dans des lieux (indécision pour leur expulsion) ou dans l’espace médiatique (recherche de controverses de la part de la presse).
Au milieu des années 1990, des évolutions internes aux organisations de « sans » bénéficient à leurs causes. Elles regroupent leurs forces dans des collectifs ou à travers des réseaux. Les militants, dotés d’un capital social et culturel plus élevé, connaissent mieux le fonctionnement des médias ; ils désignent des porte-paroles médiatiques – parfois aux dépens des plus précaires et d’organisations plus égalitaires (MNCP) –, ils calibrent leurs actions pour les médias (grèves de la faim, occupation de lieux symboliques, recours à des personnalités), développent une expertise interne en termes de droit, d’économie, gagnant ainsi en crédibilité. Parallèlement, la réduction des coûts engagée au sein des chaînes de télévision avantagent ces causes. La fermeture des agences à l’étranger conduit les reporters à se tourner vers le local. L’occupation de l’église Saint-Bernard permet de traiter d’un sujet international, les migrations, depuis Paris.
Cette visibilité accrue est l’occasion de redéfinir son identité : si la racine « sans » est volontiers endossée par les migrants en situation irrégulière et les mal-logés (elle leur permet d’échapper aux dénominations péjoratives), les chômeurs préfèrent garder leur appellation. Les « sans » deviennent une catégorie englobante qui permet d’unifier des causes hétérogènes. Reste, pour chacune, à identifier la cible de ses imputations. L’État apparaît alors comme le plus petit dénominateur commun : c’est lui qui concentre les compétences. Il doit néanmoins être ménagé car il dispense aussi les ressources convoitées.
Les journalistes, et les téléspectateurs avec eux, découvrent des visages de la crise moins caricaturaux. Il s’agit de remettre en perspective les causes structurelles de la pauvreté, d’interroger les responsabilités des pouvoirs publics, en matière de construction de logements sociaux par exemple. TF1, cependant, recourt plus volontiers au portait individuel, quand France 2 cherche davantage à mettre en perspective les causes de la pauvreté. Mais l’intérêt pour ces sujets est intermittent et inégal entre 1990 et 2002, le logement étant le moins traité des trois. Au-delà, ces causes n’ont guère attiré les caméras. Et ni les cadres de perception journalistiques, ni ceux de la production de l’information n’ont vraiment été renouvelés.
L’une des raisons tient à l’essoufflement des mouvements. Les familles de la rue du Dragon la quittent en janvier 1996, après avoir été relogées. Des figures emblématiques des organisations partent, les journalistes se lassent. Surtout, les conditions de production de l’information sont globalement peu favorables. Les journalistes travaillent dans l’urgence et sont peu spécialisés, pour des sujets souvent complexes, qui demandent du temps. Ils pratiquent le « journalisme assis », observe G. Garcia, se contentant de ce qui est accessible depuis leur bureau « directement et immédiatement ». S’y ajoute une tendance à l’auto-référencement : quand un sujet est nouveau, on regarde ce que font les collègues. Les limites imposées par le rubriquage laissent aussi peu de place à des thématiques proprement sociales. Enfin, au nom de la « neutralité journalistique », les reporters s’en référent plus spontanément à des sources accréditées, institutionnelles, favorisant les grandes organisations (le Secours catholique pour l’emploi, Emmaüs pour le logement, la Cimade pour l’immigration) aux dépens d’associations plus militantes.
L’auteur révèle par ailleurs l’importance des carrières : un journaliste qui souhaite monter dans la hiérarchie tend à rechercher le consensus. Les entretiens menés par G. Garcia soulignent cette importance du contrôle social et de l’intériorisation de la norme au sein de la profession, qui risque de mener à une forme d’auto-censure. Les reporters qui ont accédé à la profession par la « voie royale » (sciences po, école de journalisme) sont en outre moins enclins à traiter ces sujets. Plusieurs des journalistes qui ont manifesté un intérêt pérenne pour ces causes avaient des parcours plus éclectiques et y avaient été sensibilisés par leur origine sociale.
Conscient des limites de son étude et de l’immensité du champ à explorer, l’auteur dresse en conclusion plusieurs perspectives. L’une serait, à l’opposé des mobilisations de « sans », celle d’une étude des mobilisations de dominants. G. Garcia montre d’ailleurs qu’un mouvement peut être rapidement contrôlé par les pouvoirs publics. Ainsi en 2002, quand Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, reçut des sans-papiers fin août, peu après le début de leur protestation. Alors qu’il n’accéda pas à leurs requêtes, le 1er septembre, ils cessèrent leur mobilisation.
En refermant cet ouvrage, l’on peut s’interroger : les chômeurs, les sans-logis, les sans-papiers sont-ils condamnés à n’être pris en compte que par ce qui leur manque ? Des initiatives existent, dans le monde associatif (les universités populaires d’ATD Quart Monde entre autres), dans la presse (Reporters d’espoir), pour sortir de cette vision et mettre en avant ce que ces « sans » peuvent apporter à notre société. À condition que nous sachions leur faire une place, que nous sachions les reconnaître. Il y va de la dignité de chacun, mais aussi de la vigueur de notre démocratie.
18 juin 2014