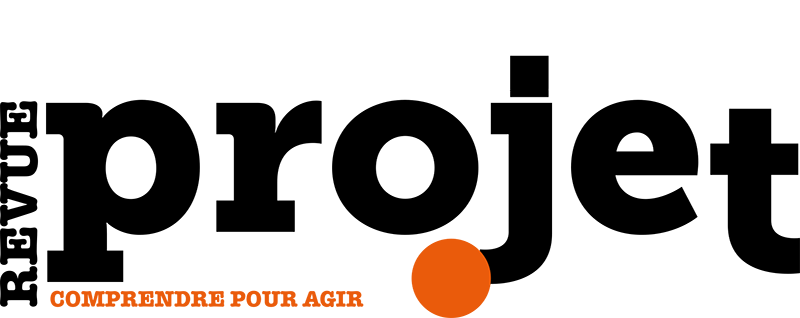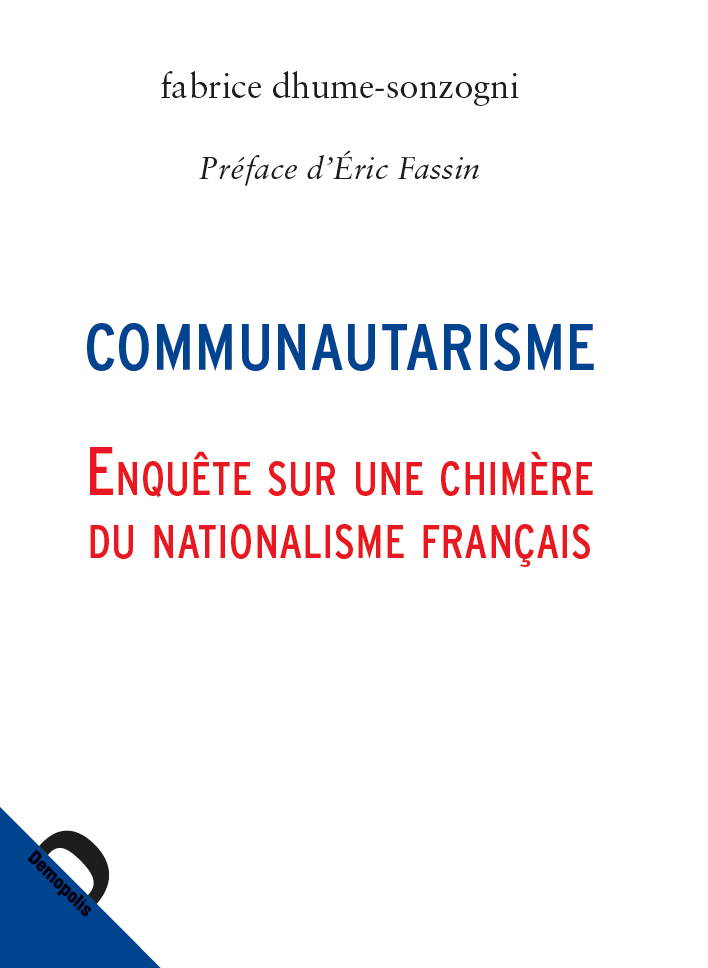Communautarisme. Enquête sur une chimère du nationalisme français
Fabrice Dhume-Sonzogni Demopolis, 2016, 226 p., 21€Communautarisme. Comment ce néologisme, inconnu il y a vingt ans, a-t-il réussi à envahir le débat public, au point de s’imposer aujourd’hui comme une évidence ? Sociologue des discriminations, Fabrice Dhume-Sonzogni interroge dans cet essai la fortune et la trajectoire de ce terme repoussoir. Analysant son occurrence et son emploi dans la presse quotidienne nationale, il met en évidence ses présupposés idéologiques. Sa thèse est que communautarisme désigne moins une réalité tangible qu’il ne recouvre une « entreprise morale et politique ». Plus qu’un concept, il est une figure rhétorique d’exclusion, visant à « disqualifier toute politique minoritaire en l’assignant à l’altérité », comme l’écrit Éric Fassin dans la préface.
À peu près absent du discours journalistique avant 1995, le mot s’impose, en l’espace de dix ans, dans les débats de société. Cette diffusion rapide et massive est due, en partie, au travail actif de plusieurs chroniqueurs, en particulier, du Figaro et du Monde (le quotidien du soir fut le premier journal à véhiculer ce terme). Sous leur plume, communautarisme vise moins des faits concrets qu’un sentiment diffus de danger pour la République, qui serait menacée par les minorités et en particulier par les musulmans. Ce n’est pas un hasard si l’usage se généralise à partir du 11 septembre 2001, en même temps que s’impose une lecture sécuritaire de l’islam qui connecte le dedans au dehors (ennemi intérieur et extérieur). Qu’il soit imputé aux musulmans, aux juifs, aux homosexuels ou aux étrangers, le communautarisme désigne l’Autre, toujours soupçonnable d’infidélité à la Nation. En effet, « il n’est jamais question de communautarisme masculin, hétérosexuel ou blanc ; c’est toujours le communautarisme des minorités sexuelles ou raciales qui pose problème » (Éric Fassin). En pointant du doigt ces communautés, le groupe majoritaire les fait exister et se pose en incarnation de l’universel.
Les promoteurs du terme assimilent le communautarisme et le « multiculturalisme » anglo-saxon, généralement opposé au « modèle français républicain ». Selon cette vision quelque peu simpliste, les sociétés anglo-saxonnes seraient composées d’une juxtaposition de communautés, alors que la société française serait caractérisée par son unité. Certains vont jusqu’à attribuer à communautarisme une origine états-unienne, le rattachant à la philosophie communautarienne. Mais celle-ci ne saurait être réduite à un éloge des communautés : elle désigne un ensemble d’auteurs qui critiquent, notamment, l’individualisme et le présupposé que les gens sont des acteurs détachés de toute appartenance. En réalité, communautarisme est un néologisme français, sans équivalent dans d’autres langues. Associé aux États-Unis, aux Balkans ou au Liban, le communautarisme est vu comme un mal venu d’ailleurs, profondément étranger au génie universaliste français. Et il aurait prospéré dans l’Hexagone, du fait de l’irresponsabilité d’une gauche supposée trop coulante avec l’islam et les communautés. Finalement, cette dénonciation est devenue une cause très fédératrice : on la retrouve de la gauche à l’extrême-droite, aussi bien à la Manif pour tous que chez des féministes historiques...
Fabrice Dhume-Sonzogni reconnaît que s’expriment par là des peurs qui ont des objets bien réels : terrorisme, insécurité sociale grandissante, affaiblissement des solidarités traditionnelles, perte de confiance dans le politique, remise en question des croyances acquises... Cependant, le discours anti-communautariste s’attaque moins aux causes profondes de ces peurs qu’il ne les instrumentalise « pour tenter d’enclencher un effet de panique morale, situation favorable à un maintien de l’ordre ». En agitant le spectre de la guerre civile, les tenants de ce discours somment les minorités de rester à leur place et de démontrer, vis-à-vis de la République, une « allégeance sans condition ni fin ». En ce sens, l’accusation de communautarisme est « le bâton qui accompagne la carotte de l’intégration ». Dès lors, la rhétorique du communautarisme n’agit pas seulement sur les représentations, elle autorise les « passages à l’acte ». Ainsi permet-elle de discréditer des associations ayant une base communautaire, de contester le droit antidiscriminatoire, voire de justifier certaines discriminations, par exemple le refus d’attribuer des logements sociaux à des familles étrangères afin d’éviter le risque de « ghettoïsation ». Cette grille de lecture sous-tend également une gestion sécuritaire des banlieues, vues comme des « zones de non-droit » en proie au « repli communautaire ». Finalement, conclut l’auteur, le discours anticommunautariste véhicule – sous couvert de la dénoncer – une logique de guerre qui se décline sur deux faces : à l’intérieur, un ensemble de dispositifs destinés à cantonner les minoritaires à une place subalterne et à restreindre, plus globalement, les libertés collectives ; à l’extérieur, une guerre contre le terrorisme qui sévit en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, au Mali, au Yémen – autant de territoires généralement présentés comme des « mosaïques ethniques » où le communautarisme irait de soi. Cette extension du propos à la géopolitique ne convainc pas pleinement car elle laisse entendre que le morcellement ethnique et religieux de ces pays serait une pure vue de l’esprit des Occidentaux, alors qu’il constitue un fait difficilement contestable (même si l’on peut interroger la responsabilité de l’Occident dans cet état de fait). C’est bien la seule faiblesse de cet ouvrage rigoureux et salutaire.
30 janvier 2017